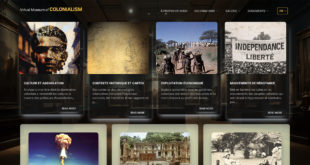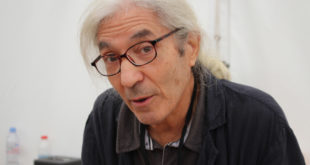Beyrouth, 1981.
Je suis un tout jeune journaliste, et je m’apprête à réaliser mon premier scoop en interviewant ce personnage que l’on présente alors comme mystérieux et insaisissable : Yasser Arafat.
Mon associé, Arnauld Hamelin, et moi-même allons lui poser la question à laquelle il n’a jamais répondu : Reconnaîtra-t-il un jour l’État d’Israël ?
C’est le hasard – ou le destin – qui m’a conduit à devenir reporter de guerre, à choisir le Proche-Orient comme terrain de prédilection, puis à co-fonder l’agence de presse Sunset, qui fut une grande et belle agence, jusqu’à ce que la presse, se diluant dans le mercantilisme à sensation, ne transforme notre vocation en mercenariat.
J’avais déjà commencé à couvrir la guerre civile au Liban, puis le conflit israélo-palestinien, en m’assignant la mission de découvrir, animé d’un manichéisme naïf que seule mon inexpérience pouvait absoudre, lequel était le bon et lequel était le méchant dans une guerre à laquelle personne ne comprenait rien.
Mon regard fut vite dessillé. Un séjour parmi les soldats de Tsahal, puis des camps de réfugiés palestiniens me fit comprendre que nul n’avait le monopole de l’inhumanité. Ou plutôt que l’apparente barbarie que je voyais si également partagée était en vérité la diabolique expression d’une terrifiante humanité. J’emploie à dessin le mot « diabolique » dans son sens étymologique. Le « Diabolos » étant ce qui sépare.
La terrifiante humanité blessée de deux peuples que les grandes puissances ont, pendant la première guerre mondiale, roulé dans la farine, en leur faisant miroiter un avenir meilleur au sein de cette terre « deux fois promise », dans la triple trahison de la déclaration Balfour, des accords Fayçal-Weizmann et des accords Sykes-Picot.
J’eus alors le premier cas de conscience de ma vie de journaliste : allais-je montrer les images de soldats assassinant des civils, de civils tuant des soldats, de civils massacrant des civils, au risque de provoquer de part et d’autre des désirs de vengeance qui s’accompagneraient inévitablement de nouveaux massacre, ou devrais-je les cacher, au risque de manquer à mon devoir d’offrir à chacun le droit à une information équitable ?
J’optai finalement pour la dernière solution, jugeant que la paix valait mieux que la vérité, me consolant en pensant à la réflexion du journaliste du film de John Ford « L’homme qui tua Liberty Valence » : « Quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende ». Je ne sais toujours pas aujourd’hui si je suis fier ou honteux de cette décision.
Je suis donc devant Yasser Arafat. Aux côtés du leader palestinien se tient Bassam Abou Charif, rendu aveugle par l’explosion d’un colis piégé envoyé par le Mossad. Arafat nous regarde dans les yeux : « Nos peuples doivent cesser de souffrir. Nous avons tous été entraînés dans un conflit que nous n’avons pas voulu, qui nous a été imposé. Il vient un moment où nous devons accepter les nouvelles réalités, même si celle-ci sont le fruit des appétits féroces des grandes puissances coloniales. A une condition toutefois, c’est qu’une reconnaissance réciproque soit guidée par la loyauté et un réel respect mutuel ». Nous sommes 12 ans avant les accords d’Oslo. Deux ans après ceux-ci, Yitzhak Rabin sera assassiné, mettant un terme à l’idée folle que l’on pourrait un jour faire taire les marchands de larmes. Le « diabolos » avait remporté la victoire. Une fois de plus.
Depuis, jour après jour, les positions se sont radicalisées. Les uns ne comprenant pas pourquoi on veut les chasser d’une terre qu’on leur avait dit leur, eux qui avait sincèrement cru à la légende de « la terre sans peuple pour un peuple sans terre ». Les autres, révoltés que des étrangers aient pu les spolier des maisons et des champs qu’ils chérissaient depuis tant et et tant de générations.
Nethanyaou présente une carte où la Palestine a disparu.
De par le monde, dans chaque foyer de l’immense diaspora palestinienne, se trouve accroché au mur un cadre dans lequel est protégé le titre de propriété de la maison perdue. Y pend un trousseau de clés, souvent avec la mention, écrite en arabe : « Nous reviendrons ». On comprend alors que, quelles que soient les armes déployées, par les bombes, à la balle ou au couteau, cette guerre fratricide durera, durera encore, des années et des années, jusqu’à ce que la raison finisse par chasser les passions.
« Il faut reconnaître la peine de l’autre ». Dans un entretien publié dans la « Revue des deux mondes » en 2009, François Léotard et Elias Sanbar évoquent la nécessité pour chacun de prendre en considération le sentiment profond du peuple d’en face, faute de quoi le dialogue restera éternellement sourd.
C’est aussi le travail du journaliste que de présenter la vision des deux antagonistes sans chercher à prendre parti. On ne demande pas au journaliste d’être « objectif », car on ne peut l’empêcher de voir aussi avec son coeur, mais il a une exigence d’honnêteté. Et l’honnêteté, c’est donner la parole à tous. Au lecteur ou au spectateur de se faire une opinion après un débat équilibré.
Or la presse française présente le visage d’une consternante uniformité. D’un titre à l’autre, les mêmes articles délivrent des messages copiés-collés. A peine quelques nuances de style, de « Belle Marquise vos beaux yeux me font mourir d’amour » à « Belle Marquise, d’amour vos beaux yeux mourir me font », si on peut parler de style à propos de plumes aussi serviles. Les bourgeois de l’information ne sont pas toujours des gentilshommes.
Contrairement à ce qui se passe à l’étranger, et même aux États-Unis, la presse française prend unanimement parti, le même parti, qu’il s’agisse du conflit israélo-palestinien ou celui du Caucase. Tout sur les centaines de morts et de prisonniers de l’attaque du Hamas, rien sur milliers de Palestiniens tués depuis des années, ni les 7000 personnes emprisonnés actuellement sans jugement dans les geôles d’Israël. Tout sur les 100 000 exilés arméniens du Haut-Karabakh, rien sur le million d’Azéris chassés de leurs terres arméniennes ou azerbaïdjanaises en 1987 et 1992. Il ne s’agit pas de désigner les coupables ou les victimes. Chacun sa perception. Il s’agit juste d’être juste.
Même le nouveau titre dominical, qui promettait du renouveau, ne parvient pas à faire la différence et joint sa voix au même discours monocorde. A qui la faute ? A la monopolisation oligarchique de l’information ? Ou bien à la dérive médiatique qui s’appuie sur le poids des mots et le choc des photos pour vendre du papier ou s’acheter de l’audience, faisant de l’information un produit comme un autre, qu’on balance à la tête du public comme une pub pour une bagnole ou une crème anti-rides ? Mais quid de la conscience du journaliste ?
Le problème, c’est que tous ces gens s’imaginent convaincre. La réalité est que ni les politiques, ni les journalistes ne sont plus crédibles. Les électeurs ne vont plus aux urnes, le public, surtout le plus jeune, se tourne désormais vers les medias on-line, Youtube, Tiktok ou X, où des chaînes alternatives tentent d’apporter une information plus équilibrée. C’est peut-être un bien, mais un danger nouveau se pointe à l’horizon : celui d’une info non maîtrisée, diffusée par des auteurs qui n’ont pas de reçu de formation professionnelle, si tant est que celle-ci existe encore aujourd’hui. Des brèves de comptoir à l’audience planétaire en somme. C’est aussi, à l’inverse, celui d’une censure sournoise qui vient de s’exprimer par une menace de Thierry Breton et d’un tacle de retour assassin d’Elon Musk.
Il est trop facile pour nous, journalistes, de nous sentir à l’abri derrière nos papiers ou nos caméras. Nous avons notre responsabilité dans le malheur du monde.
 Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France
Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France