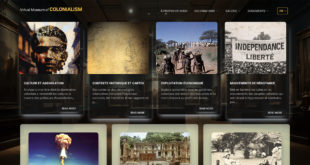Par Sadek Sellam
La déprogrammation par la cinquième chaîne du documentaire de Claire Billet sur l’utilisation des gaz pendant la guerre d’Algérie a de quoi inquiéter ceux qui espéraient des avancées dans les débats mémoriels. Cette censure semble traduire une volonté d’imposer un « historiquement correct » déterminé par des débats de journalistes peu intéressés par la vérité historique.
Pour dissiper cette fâcheuse impression, la Cinq a diffusé, le 24 mars, un débat sur la guerre d’Algérie où tous les invités étaient des journalistes, hormis Benjamin Stora. Ni Claire Billet, la réalisatrice du documentaire sur les gaz, ni l’historien Christophe Lafaye dont les travaux permettent une estimation d’un nombre élevé de victimes de cette méthode « oubliée » de « pacification », n’ont été invités. Au lieu de la révision en hausse du nombre de victimes de toute la guerre qu’imposent désormais les révélations faites par Christophe Lafaye, on eut droit à une série de lieux communs de journalistes qui n’ont pas tous intégré dans leur culture générale le savoir minimum sur la guerre d’Algérie qui en ferait les « interlocuteurs valables » des spécialistes.
Inquiétant débat sur la Cinq
Le patient chercheur, que n’ont pas découragé les refus de ses demandes de dérogation pour consulter les archives des « sections-grottes », estime à 10000 le nombre d’opérations menées par ces redoutables et actives unités. Une seule de ces opérations a fait 150 victimes. Cela donne facilement un nombre de victimes à cinq chiffres qui devrait être ajouté aux 300.000 victimes de toute la guerre. C’est Benjamin Stora qui a avancé ce chiffre dans le débat qui a suivi la rediffusion d’un de ses documentaires sur la LCP. Guy Pervillé s’en tenait aussi à ce chiffre jusqu’à ce que Fabien Sacriste soutienne sa thèse sur les camps de regroupements. Le doctorant, qui a travaillé sous la direction de Pervillé, estime à 200000 le nombre des victimes décédées lors des déplacements de population des zones interdites vers les camps de regroupements- que Pierre Mendès-France n’hésitait pas à appeler « camps de concentration »[1]. Pervillé admet qu’il faudrait ajouter les 200000 au chiffre des victimes de toute la guerre. On sait que les habitations des zones interdites étaient détruites au bulldozer et à la TNT pour empêcher tout retour. Il était impossible de transporter ces matériels dans les villages de haute montagne, accessibles seulement par des chemins muletiers. L’aviation militaire se chargeait dans ces cas de les bombarder. Un de ces bombardements de décembre 1956 en Grande-Kabylie a fait 950 morts[2]. On devrait tenir compte de ce recours à l’aviation pour détruire plusieurs mechtas pour réviser en hausse le chiffre de Fabien Sacriste. Stora aurait pu tirer ce genre de conclusions. Il ne l’a pas fait parce qu’à la télévision on procède à un nivellement par le bas. Il ne désespère sans doute pas de vulgariser son savoir historique auprès des journalistes de bonne foi. Il en est résulté un débat très décevant et, même, préoccupant.
Un des invités a cru en effet avoir trouvé (mais sans dire comment) que le nombre d’habitants de l’Algérie en 1830 serait égal à celui des immigrés algériens aujourd’hui en France, soit 900000 !!! La bienveillance de Stora lui fait croire qu’il a raison.
Ce démographe d’un soir habitué à donner au faux les apparences du vrai, est pris au sérieux par ceux qui ne se souviennent pas de son article, pourtant difficilement oubliable, dans le Monde où il a multiplié par deux le nombre de pèlerins au pèlerinage de 1991 qui a suivi la première guerre contre l’Irak[3].
Le débat démographique verrouillé par le Monde en 1961 sera-t-il rouvert par les commissions d’historiens ?
Au cours du débat du 24 mars, Stora a indiqué que les commissions d’historiens veulent « commencer par le commencement », et travaillent en ce moment sur les débuts de la conquête. Ils seront amenés à rouvrir le débat sur la démographie de l’Algérie. Ce débat avait été ouvert par Michel Habart dans son livre « Histoire d’un parjure »[4]. Charles-André Julien, qui occupait la chaire d’histoire coloniale à la Sorbonne, a réagi violemment contre ce livre qui cite le « Miroir » où Si Hamdan Khodja estimait, en 1834, la population algérienne à 10 millions. L’historien et ancien parlementaire SFIO a contesté le chiffre de Si Hamdan, et a été jusqu’à s’interroger sur l’historicité de ce dernier. Cet ancien président du « Haut Comité de la Méditerranée », créé pour lui en 1936 par son ami Léon Blum, après la dissolution de la Commission Interministérielle des Affaires Musulmanes, avait recommandé en 1937 une surveillance par la police spéciale de la rue Lecomte de l’enseignement de l’arabe aux travailleurs immigrés par les Oulama. Dans un rapport sur l’Afrique Occidentale Française, il recommandait aux gouverneurs locaux de s’appuyer sur les confréries maraboutiques, comme en Algérie[5]. Sa contestation vigoureuse du livre de Michel Habart était inspirée par un orgueil de l’ « Homo Academicus », vexé de voir un essayiste révéler ce que les historiens avaient négligé d’étudier, ou refusaient de publier. Revenu à la raison, ce grand historien qui avait les défauts de ses qualités, a cité abondamment le Miroir de Si Hamdan dans son livre sur « l’Algérie contemporaine »[6]. Il a même regretté que ce dernier ait renoncer aux révélations qu’il menaçait d’ajouter à celles du « Miroir ». « L’historien ne peut que regretter la discrétion de Si Hamdan », déplorait-il.
M. Habart a préparé une réponse détaillée en quatorze points. Mais le Monde a refusé de le publier au motif qu’il n’était pas historien. Dans un des points de sa réponse aux attaques de C.-A. Julien, M. Habart cite l’archevêque d’Alger, Mgr Duputch qui, dans une lettre au Pape, estimait la population algérienne à 8 millions. A cette période, l’Eglise pouvait être mieux renseignée que l’Etat lui-même. Dans une lettre non publiée également par le Monde, Xavier Yacono, professeur à l’université d’Alger, estimait à 4 millions la population algérienne en 1830[7]. Si ce débat verrouillé par le Monde par révérence pour « le Professeur C.-A. Julien » est repris par les commissions d’historiens qui travaillent sur les débuts de la conquête, les historiens algériens ne rejetteront pas d’un revers de la main les chiffres de Si Hamdan et de Mgr Duputch, même si des membres de la commission seront tentés de s’inspirer du refus en bloc de C.-A. Julien. Quel que soit le compromis entre historiens, le chiffre retenu sera comparé à celui du recensement du début des années 1870, estimant la population algérienne à près de deux millions. Où sont passés les huit millions si l’on retient le chiffre de Si Hamdan ? Que sont devenus les six millions si l’on retient celui de Mgr Duputch ? Quel fut le sort des deux millions si l’on s’en tient à l’estimation de Yacono[8] ?
Au lieu de ces questions que doit se poser tout historien impartial, l’apprenti-démographe qui a sévi le 24 mars sur la Cinq fait croire que la conquête aurait été bénéfique à la démographie algérienne comme les camps de regroupement (c’est-à-dire de concentration) lui furent profitables en lui évitant l’illettrisme. La recherche de la vérité est le dernier des soucis de ce singulier journaliste. En cherchant visiblement à plaire aux journalistes-idéologues qui se déchaînèrent contre Jean-Michel Aphatie, il espère être invité aux prochains débats.
Contrairement à Julien qui disqualifia Habart au nom de l’histoire, les historiens spécialistes de l’Algérie, sauf un, n’apportèrent pas leur caution aux campagnes contre Aphatie, accusé d’avoir blasphémé. L’historien qui s’est associé aux critiques contre Aphatie fait partie de la Commission française d’historiens qui cherchent à dialoguer avec les historiens algériens. Il risquerait de s’inspirer des négations de Julien. Dans ce cas, la recherche sur les débuts de la conquête annoncée par Stora risquerait d’être laborieuse pour cause de blocages idéologiques comme ceux de l’historien indigné par la comparaison d’Aphatie.
Jean-Michel Aphatie n’a pas blasphémé
Si l’on se souvient des « témoignages de rappelés » publiés après l’affaire Bolladière(1957), on s’aperçoit que la comparaison avec Oradour-sur-Glane n’a rien de sacrilège. Un des jeunes du contingent déclara en effet: « en Algérie, des Ouradour, nous en faisons tous les jours ! »[9].
Il y eut aussi la révélation à un JT de 20h de 1985 sur TF1 de la découverte d’un charnier de 1000 hommes à Khenchela. Le journaliste a conclu tranquillement par une comparaison avec Oradour, sans provoquer aucune contestation[10].
Comme ce charnier de Khenchela est loin d’être le seul, une estimation du nombre de morts sous la torture qui n’étaient enregistrés nulle part devrait conduire à une autre révision en hausse du nombre de victimes de toute la guerre.
Le nombre de victimes de toute la guerre est déduit du chiffre communiqué en 1962 par le général De Gaulle à Raymond Tournoux[11]. Dans cette extrapolation, le nombre de civils tués est estimé à moins de 80000. Cette estimation ne semble tenir compte que des tués parmi les membres de l’OPA, que les deuxièmes bureaux locaux n’ont jamais réussi à bien connaître[12].
La comptabilité qui estime à 300000 les victimes de toute la guerre ne tient pas suffisamment compte des massacres de civils. Ces massacres ne sont pas de simples « exactions ». Ils sont devenus très fréquents, car le principe de la responsabilité collective était en vigueur à partir de 1955.
Pour une révision en hausse du nombre de victimes de toute la guerre.
Au début de la guerre, ces massacres pouvaient faire 400 victimes en une seule nuit. C’est la répétition de ces carnages qui fit sortir de sa réserve le « modéré » Abderrahmane Farès, sur lequel misait le gouverneur Jacques Soustelle pour prendre la tête d’une « troisième force ». Après les massacres de Ouled Antar et de Ouled Hamza, près de Boghari, situés dans sa circonscription de délégué à l’Assemblée algérienne, Farès dénonça cette singulière forme de « pacification », dans une lettre ouverte à Robert Lacoste, paru dans le Monde en septembre 1956[13]. En 1957, la tuerie du Ruisseau à Alger fit plus d’une centaine de morts. La répétition de ces pratiques fit sortir de leur réserve des membres du clergé officiel musulman, connus pourtant pour leur docilité. Ces muftis ont écrit au président de la République au nom d’un humanisme religieux, après avoir constaté que les principes laïques restaient sans effets[14]. Encouragés par les vengeances contre les civils menées par l’Armée, des colons se permettaient de lui servir d’auxiliaires. Le fils d’un colon de la Mitidja a tué en novembre 1956, une douzaine de civils rencontrés sur la route entre Mouzaïa et El Affroun. Le directeur de l’école de Mouzaïa, Imalahyène- un proche de Farès, qui était aussi modéré que lui, et était le père d’Assia Djebbar- a signalé ce carnage au Monde, qui n’a rien publié.
La même année, le docteur AÏssa Bensalem, président du Conseil général de Constantine, interrogé par le président René Coty sur la « pacification », répondit : « Monsieur le président, ce que Lacoste appelle « pacification » est une véritable extermination ! »[15]
Les massacres de civils diminuèrent un peu quand les opérations du plan Challe de 1959 visaient prioritairement les katibas régionales et les sections sectorales de l’ALN. Mais l’ordre de fractionnement des katibas privait Challe des victoires escomptées. Les officiers français n’hésitaient alors pas à se venger contre les civils. C’est ainsi qu’une tuerie dans les monts du Bissa (entre Ténès et Cherchel) fit, en mars 1960, 178 morts, tous des femmes, enfants et vieillards[16].
A la même période Jules Roy, parti en Algérie enquêter sur les réalités de la « pacification », a dénombré 1600 disparitions à Toudja, une petite localité de petite-Kabylie[17].
Malgré la présence dans le cabinet du Délégué général, Paul Delouvrier, d’un conseiller chargé des droits de l’homme, le chef syndicaliste Aïssat Idir a été trouvé brûlé la veille de sa libération avec des milliers d’ « hébergés ». Dans ses entretiens avec Odile Rudelle, Delouvrier met en accusation le colonel Godard, alors Directeur de la Sûreté, qui était hostile à ces libérations, au motif que les libérés allaient rejoindre les maquis, ou militer dans l’OPA[18].
Tous les chiffres de la guerre d’Algérie peuvent être revus et corrigés, au risque de perturber les âmes sensibles des chaînes d’information continue et les pourfendeurs d’Aphatie. Ce fut le cas pour le nombre de déplacés des Zones interdites. Dans sa première série télévisée de 1990, Stora s’en tenait au chiffre de Michel Rocard dont le rapport de 1959 estimait à un million le nombre de paysans chassés de leurs terres pour être parqués dans les camps de regroupement.
La recherche impartiale a permis de réviser en hausse le nombre des déplacés des zones interdites
Ce chiffre a été révisé en hausse quand C.-R. Ageron a estimé à deux millions le nombre de déplacés. Le grand historien, qu’on ne voyait presque jamais à la télévision, avait eu accès aux archives du général Parlange, qui était chargé des regroupements jusqu’en 1960 . Après cette date, on ne parlait plus de « regroupements », ce qui faisait croire à la cessation des déplacements de population. Les rapports faisaient état des « resserrements »[19]. Si l’on ajoute le nombre des « regroupés » à celui des « resserrés », le nombre des déplacés atteint facilement trois millions, soit le tiers de la population algérienne.
Les rapports périodiques de l’ALN, qui étaient d’une grande précision, signalaient la continuation des déplacements de population après 1960. Après le départ du général Challe en avril 1960, son successeur, le général Crépin continuait les déplacements de population[20]. Il se contentait d’un changement de terminologie qui faisait croire à une « pacification » à visage humain.
A la même période, l’ALN informait ses officiers qu’une grave épidémie sur un rayon de 100 kms avait été provoquée par un « bombardement bactériologique ». Le médecin de la Wilaya 4 signataire de ce document recommandait de le maintenir « très secret » afin d’éviter d’ « affoler les populations » chassées des zones interdites.
Une note de service du colonel Argoud, alors chef d’état-major du général Massu au Corps d’Armée d’Alger, ordonnait l’empoisonnement des points d’eau. Après avoir fait des victimes parmi les djounoud qui se précipitaient pour boire après chaque repli, cet empoisonnement a décimé le bétail. L’ALN a limité le nombre de victimes en ordonnant de tester d’abord l’eau avant de la boire, ou de se laver. Argoud avait été dénoncé par le colonel Bigeard qui réprouvait sa justice expéditive consistant à faire fusiller des suspects dont les cadavres étaient exposés toute la journée sur les places publiques des localités de l’Est algérois. Argoud révéla à son tour le charnier de 60 cadavres découvert par ses patrouilles qui accusèrent les paras du RPC (Régiment des Parachutistes Coloniaux) du colonel Bigeard d’enterrer de nuit les suspects qui décédaient dans les centres de torture d’El Biar.
Pour sa part, la wilaya 5 (Oranie) faisait état d’un empoisonnement par l’armée d’une cantine scolaire « pour indigènes ». Il y a de quoi faire crier d’indignation les contradicteurs de J.-M. Aphatie plusieurs fois par mois!
Il y aurait à tenir aucun compte aussi des nombreuses autres victimes de procédés comme ceux dont fait état J.-J. Servan-Schreiber dans son excellent livre publié à son retour d’un secteur de la Zone Est-Algérois où il avait été rappelé à « pacifier » pour l’empêcher de continuer ses campagnes contre ce que Claude Bourdet, un grand résistant, appelait des « pratiques nazies » [21]. JJSS révèle les « tirs a priori » consistant à aligner plusieurs dizaines de chars pour tirer sur une « forêt suspecte » toute la journée. A la fin de l’exercice, on trouve des morts parmi les jeunes bergers et les femmes venues ramasser du bois pour le pain de midi. Ces victimes ne sont répertoriées nulle part. JJSS parle aussi de l’extermination d’un groupe de 17 ouvriers de la mine d’Arbatache qu’on a voulu déclarer comme des « éléments du commando Ali-Khodja en civil ». Mais pour rendre le rapport du 2° Bureau crédible, il fallait déclarer le nombre d’armes récupérées. Comme il n’y en avait pas, aucun rapport n’a été rédigé.
Dans ce secteur connu pour son centre de torture d’El Khadra, il y avait eu une tuerie qui fit 150 morts à Rivet(aujourd’hui Meftah), pour venger l’embuscade d’El Ghaliz tendue début 1956 par la section Ali-Khodja avant celle de Djerrah du 18 mai 1956, qui fut plus médiatisée. En 1959, il y eut une autre tuerie à Rivet
Tenir compte des avis de « ceux d’en face ».
On devrait tenir compte également de l’avis de « ceux d’en face » pour une qualification satisfaisante des crimes de la « pacification ». Sont dignes d’intérêt les jugements d’un pur produit de l’école française, qui ne parlait pas l’arabe, et qui s’est trouvé chargé du service d’information de la Wilaya 4, Boualem Oussedik. Ce licencié-ès-lettres, nourri de lectures humanistes, étaient imprégnées des valeurs apprises en lisant notamment Paul Valéry. Les bombardements au napalm, les incendies de mechtas et les vengeances contre les civils avec des bilans à trois chiffres l’amenèrent à s’interroger sur l’« humanisme », sublime et universalisant enseigné par ses maîtres de l’université d’Alger, mais que la « pacification » réduisit à l’état de paroles verbales. Dans une de ces « Lettres du Maquis », cet ex-francophile (qui n’était pas moins attaché à la culture française que Boualem Sansal et Kamel Daoud), rendait la « France coloniale » (il espérait un sursaut de l’autre France) « responsable d’une politique de rapines, de crimes, de destruction des cultures, de viol des âmes par la dépersonnalisation »[22].
Après les carnages répétés dans l’Atlas blidéen, dont il informait régulièrement par voie postale Hubert Beuve-Méry (qui n’a jamais rien publié dans le Monde), ce grand déçu de l’humanisme français n’hésitait pas à choquer les âmes sensibles de l’époque en écrivant :
« Je crois comprendre maintenant qu’à vos yeux le crime des nazis pendant la dernière guerre , a été d’avoir utilisé contre des Européens des procédés jusque-là réservés aux seuls peuples colonisés d’Afrique et d’Asie »[23].
Dans les témoignages recueillis ces dernières années par la Fondation de la Wilaya 4, les anciens de l’ALN, très souvent arabophones unilingues- qui n’ont donc pas lu Courrière, et ne savent pas qui est Stora- relatent très souvent, et avec précision parce que ça les a marqués, les vengeances contre les civils[24].
Les rapports périodiques de Mintaqa comportent une rubrique « massacres de civils » et permettent de supposer que le nombre de ces victimes innocentes est quatre fois plus élevé que celui des djounoud en uniforme[25].
« La vérité rend libre »
Du côté algérien, rien n’empêche de reprendre le projet de « Livre blanc des atrocités » que le GPRA (Gouvernement provisoire de la République Algérienne) voulait éditer, sur la base des témoignages demandés aux wilayas. Mais le GPRA renonça à cette publication quand il a été convaincu de la volonté de paix du général De Gaulle via les émissaires du « gaullisme exploratoire »[26].
Cela ne serait pas moins utile que la demande de restitution du Coran et du sabre de l’émir Abdelkader[27]…
On sait que la « vérité est la première victime des guerres ». La vérité historique risquerait d’être à nouveau victime des « préoccupations et consécrations journalistiques », déplorées par Pierre Bourdieu dont on sait les jugements sévères portés sur les chercheurs complaisants avec les médias.
Le monopole des débats mémoriels par des journalistes-idéologues cherchant à faire cautionner leurs préjugés par les rares historiens invités à la télévision risquerait de sacrifier la vérité historique au profit de « vérités » médiatiques où s’additionnent des demi-vérités à quelques contre-vérités, comme celle proféré l’autre soir sur la Cinq par l’apprenti-démographe désireux d’être invité plus souvent. Livrée à ceux qui courent derrière la médiatisation, l’histoire dramatique de la conquête et de la décolonisation risquerait d’être falsifiée par ceux qui recherchent de nouvelles rentes mémorielles au mépris de la vérité historique. L’usage de la mémoire coloniale à des fins de médiatisation satisfait des désirs de paraître et fait ressembler les débats sur la guerre d’Algérie aux controverses sur l’Islam, où les musulmans restent les grands absents.
La « vérité rend libre », selon la parole de l’Evangile.
__________________________________
- Mendès-France osait appeler les choses par leur nom dans une de ses conférences de presse mensuelles sur la guerre d’Algérie publiée dans un numéro de l’Express de 1961. ↑
Chiffre cité par Mohamed Téguia dans l’Algérie en guerre. OPU. Alger. 1987. On a une idée de la quantité de matériels (bulldozers et TNT) demandés pour détruire les habitations des zones interdites à la lecture d’une note du lieutenant Schmitt qui était chargé de raser les habitations d’un secteur de la Zone Est-Algérois où il a été affecté après ses exploits durant la bataille d’Alger. ↑
Après la première guerre contre l’Irak, le journal Le Monde (qui était pour « la logique de guerre » et bienveillant avec l’Arabie séoudite) avait commandé à ce démographe d’un soir un article sur le pèlerinage de 1991. A la Une du Monde, il a estimé à 1,5 million le nombre de pèlerins. La même semaine l’envoyée spéciale de l’Express n’en a dénombré que 700000 . Tout le monde s’attendait au boycott du pèlerinage de 1991 en raison du mécontentement provoqué par l’utilisation par l’armée américaine de la base séoudienne de Dhahran, sauf cet apprenti-démographe qui, poussé dans ses retranchements, avouait s’être contenté de reprendre le chiffre de l’ambassade séoudienne. Plus récemment, il a rendu hommage aux camps de regroupements qui lui auraient permis d’apprendre à lire et à écrire, mais visiblement pas à compter… ↑
Paru aux éditions de Minuit en novembre 1960. M. Habart cite Le Miroir de Si Hamdan Khodja, paru en 1834. ↑
Se souvenant sans doute de ce passé du grand historien, Jacques Berque disait que « l’anticolonialisme de Charles-André était bien tardif ». ↑
Paru aux PUF en 1964. ↑
Les courriers non publiés par le Monde qui a verrouillé le débat en donnant le dernier mot au « professeur C.-A. Julien », qualifié de « grand historien », sont consultables aux archives de Robert Gauthier, alors rédacteur en chef adjoint, et ami de Julien. Centre d’Histoire contemporaine de la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Dans une de ses rencontres avec la presse, le président Tebboune estime à 4 millions le nombre d’habitants de l’Algérie en 1830. Ce chiffre a dû lui être communiqué par un membre de la commission d’historiens au fait de l’estimation de Yacono. On aimerait en savoir plus sur les travaux des deux commissions sur les débuts de la conquête et au nom de quoi se trouveraient rejetés les chiffres avancés par Si Hamdan et Mgr Duputch. Dans une tribune d’un historien du CNRS, parue dans le Monde en mars 2025, ce chercheur cite l’estimation de Yacono mais en y retranchant un million. ↑
Dans une récente tribune publiée dans le Monde, un historien du CNRS trouve le moyen de retrancher un million à l’estimation de Yacono. ↑
Cité dans Mohamed Téguia : l’Algérie en guerre. OPU. Alger. 1987 ↑
Selon un historien de la wilaya des Aurès, moins idéologues que les auteurs de notices sur cette wilaya dans « le Dictionnaire de la guerre d’Algérie, dans ce charnier étaient enterrés secrètement les suspects victimes des « interrogatoires poussés » dans le DOP d’en-face. Il va sans dire que ces enterrements secrets n’étaient enregistrés nulle part.
Ce « Dictionnaire » n’est pas exempt de révisionnisme chiffré. Dans une notice sur le « Crime contre l’Humanité », une historienne-idéologue décide qu’il n’y en a pas eu en Algérie. Pour illustrer sa négation, elle conteste le chiffre des 45000 morts de mai 1945, en prétendant qu’il aurait été inventé par le pouvoir algérien « à des fins de légitimation ». Tout le monde sait que ce chiffre a été avancé par le PPA en 1945. Dans une note jamais exploitée de la présidence de la République, le nombre des victimes de la répression de mai 1945 est estimé à au moins 30000. Cela rapproche du chiffre du PPA et éloigne de l’estimation donnée par C.-A. Julien dans « l’Afrique du Nord en marche », paru en 1952. Parce qu’il était l’ami du gouverneur socialiste Châtaigneau, on crut que Julien avait recueilli ses confidences. Pour cela, beaucoup continuent de citer les chiffres de Julien sur mai 1945 sans admettre qu’on puisse les contester. Enfin, dans les 1700 pages du « Dictionnaire », les archives du préfet Mécheri où se trouve la note estimant à 30000 le nombre des victimes de 1945, sont totalement ignorées par les savants rédacteurs de notices. ↑L’Etat-Major Interarmes d’Alger, qui renseignait De Gaulle avec moins d’hésitations que René Coty, estimait à 224000 le nombre de combattants de l’ALN en arme et en uniforme tués dans les combats. ↑
Ageron a dit un jour que « l’OPA n’a peut-être jamais existé ». Le grand historien réagissait à l’apparition à partir de 1960 dans les rapports du deuxième Bureau du sigle « ORU » (Organisation Rebelle Urbaine), composée d’officiers de l’ALN qui quittèrent, après le plan Challe, les djebels pour s’installer en ville. ↑
Le tapuscrit de cette lettre est consultable dans les archives de Mécheri. Farès tenait à informer le président René Coty qui se plaignait d’être privé des rapports par Lacoste et Lejeune. ↑
Lettre au Monde. Le Monde a censuré également une lettre d’une ancienne directrice d’école, Mme Smadja, d’origine juive et solidaire de ses instituteurs enlevés en 1957, à Boghari. Elle informait Beuve-Méry des conditions horribles de leur mort. Il y avait parmi ces « disparus », le père de la romancière Maïssa Bey. ↑
Le Dr AÏssa Bensalem, président du Conseil général de Constantine faisait partie d’une délégation d’élus musulmans que le préfet Mécheri, secrétaire général du Conseil de l’Union française, faisait venir à l’Elysée pour informer la président René Coty à qui Max Lejeune, secrétaire d’Etat à la Guerre, refusait de communiquer les rapports du 2° Bureau qui rendaient compte des réalités. . ↑
Une liste nominative de ces victimes a été récupérée au PC de la Wilaya 4 où fut tué le commandant Si Mohamed Bounaama. La famille Krimi fut la plus éprouvée. Elle perdit une quinzaine de ses femmes et enfants parce que un de ses membres, Si Mourad, faisait partie du conseil de la Mintaqa 3 de la Wilaya 4. Ces carnages de « l’armée du crime »(comme l’appelait le commandant Si Mohamed dont la mère et l’épouse avaient été victimes d’exécutions sommaires) eurent lieu quand débutaient les négociations secrètes avec le conseil de la wilaya 4, en vue du cessez-le-feu de « l’Algérie algérienne ». Des officiers subalternes sabotèrent l’accord de cessez-le-feu parce qu’ils ne voyaient pas les effets des gages donnés par les négociateurs français, Bernard Tricot et Edouard Mathon.. ↑
Jules Roy : la guerre d’Algérie. Julliard. 1960. La SAS locale fit croire à Roy que ceux qui manquaient à l’appel étaient partis travailler en France, ou étaient dans les camps d’internement. Ce courageux enquêteur fit les vérifications nécessaires et conclut que les 1600 avaient été exécutés. Ces exécutions ne figurent sur aucun régistre. ↑
Les entretiens enregistrés par Odile Rudelle avec les principaux acteurs de la guerre d’Algérie sont au Centre d’Histoire Contemporaine de Sciences-Po. Mendès-France et Mitterrand refusèrent de répondre aux questions parfois embarrassantes de l’historienne. Ce riche fond d’archives est également ignoré dans le « Dictionnaire de la guerre d’Algérie » où il y aurait eu moins d’erreurs si les rédacteurs de notices l’avaient consulté. La responsabilité de l’Etat dans la mort d’AÏssat Idir mériterait d’être reconnue au même titre que celles d’Ali Boumendjel, de Maurice Audin et de Larbi Ben M’hidi. Pour ces derniers, les aveux d’Aussaresses servirent d’arguments. Que l’on sache, Delouvrier n’est pas moins crédible que l’ex-commandant O. ↑
La même année, fut annoncée la dissolution des DOP, centres d’ « interrogatoires poussés ». Mais peu de gens savaient que la suppression d’un sigle ne signifie pas nécessairement la fin de la torture. On vit apparaître un nouveau sigle, les SOR(Sections Opérationnelles de Renseignement), où l’on continuait à interroger, torturer et à enterrer secrètement ceux qui succombaient à la torture. De la même façon, fut déclarée la suppression du V° Bureau de l’Etat-Major chargé de l’Action Psychologique, dont le colonel Gardes fit un « Etat dans l’Etat », selon le Délégué général Paul Delouvrier. En fait, l’opération a consisté à muter Gardes à la tête d’un secteur mal pacifié. On vit apparaître dans les organigrammes militaires l’appellation « Problèmes humains » pour désigner un service qui continuait l’Action psychologique comme du temps de Gardes, mais sans tentatives de manipulation des médias. ↑
« Crépin continue les déplacements de populations », poursuivis par Challe », écrivait en avril 1960 dans un rapport de la Région 3 de la Zone 2 de la Wilaya 4 d’avril 1960, le sous-lieutenant Boualem Séghir (Dellouci). ↑
« Lieutenant en Algérie ». Julliard. 1957 ↑
Lettre du Maquis de décembre 1956. Service Historique de la Défense. 1H2590. Presse rebelle. Consultable sans dérogation. ↑
Ibid. la « pacification » faisait souffrir encore plus Taha Husséin, un grand francophone, très francophile qui participa, la mort dans l’âme au colloque de 1958 au Caire pour dénoncer les crimes coloniaux. Les actes de ce colloque ont été réédités à Alger en 2011. Leur traduction donnerait à réfléchir aux détracteurs de J.-M. Aphatie. . ↑
Cette Fondation a enregistré 26000 témoignages qui ont intéressé les Archives nationales. Mais ces témoignages sont superbement ignorés par les rédacteurs du Dictionnaire de la guerre d’Algérie qui comporte des notices approximatives, parfois inexactes, sur la Wilaya 4. ↑
Quand j’ai cité cette estimation à un commandant de l’ALN qui avait été à la tête d’ une unité élite dont la combativité et l’agressivité sont reconnues dans les rapports du Deuxième Bureau, il s’est écrié : « beaucoup plus ! » Ce témoin oculaire des mechtas rasées et des massacres de masse n’est pas le seul à trouver indécent le chiffre des 300000 supposées être les victimes de toute la guerre. Il faut espérer que ce commandant n’a pas vu l’émission de la 5 où un apprenti-démographe a trouvé que le nombre d’Algériens de 1830 serait égal à celui des immigrés venus d’Algérie en France. ↑
Selon la formule, d’Albert-Paul Lentin dans « le Dernier quart d’heure ». réédité par Alam al Afkar avec une présentation de Sadek Sellam. Alger. 2010 ↑
En 1949 Naegelen a érigé une statue à Cacherou après avoir refusé d’autoriser un film américain sur l’émir Abdelkader. On peut difficilement réconcilier les mémoires si l’on continue de paraphraser le gouverneur socialiste qui voulait récupérer la mémoire de l’émir dont les portraits géants étaient dans les locaux des partis nationalistes. ↑
 Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France
Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France