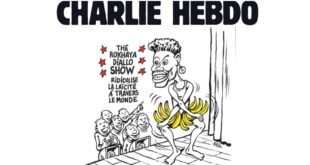Venue d’Ouzbékistan, la directrice du Théâtre républicain des jeunes spectateurs de Tachkent, Zulfiya Khamraeva, a participé au festival Off d’Avignon dans le cadre des Journées de l’Asie centrale. Elle y défend une vision du théâtre comme vecteur de paix, d’éducation et d’échange dans une région encore marquée par les tensions post-soviétiques.
Loin des clichés sur les steppes et les anciens caravansérails, l’Asie centrale se réinvente à travers ses scènes de théâtre. Et à Avignon, dans le cadre du festival Off, cette réinvention prend une voix féminine, engagée et résolument tournée vers la jeunesse. « Notre mission, c’est de former des générations cultivées et ouvertes», explique Zulfiya Khamraeva. « Le théâtre, c’est le lieu où une nation apprend à se connaître, à réfléchir, à transmettre. »
Une diplomatie culturelle venue du cœur de l’Asie
Depuis sa nomination à la tête de l’institution ouzbèke, Zulfiya Khamraeva a fait de la coopération régionale et internationale un pilier de son action. « Nous vivons dans une région encore tiraillée entre héritages soviétiques, réveils identitaires et ambitions numériques. Le théâtre peut jouer un rôle de médiateur — au sein même de notre société, mais aussi entre pays voisins. »
À Tachkent, elle a fondé deux festivals internationaux, dont « Enfants du XXIᵉ siècle », accueillant récemment des troupes de Géorgie, du Kazakhstan, d’Azerbaïdjan, de Russie et de Chypre. Des mémorandums d’accord ont été signés pour développer des projets communs, des coproductions, des formations croisées. « Nous avons un besoin vital de sortir de nos frontières mentales et culturelles, d’échanger nos savoir-faire. L’Asie centrale a beaucoup à offrir — et encore plus à apprendre. »
Une région, des héritages multiples
Dans cette région stratégique entre Chine, Russie, Iran et monde turc, l’identité culturelle est une question sensible. Le théâtre, selon Zulfiya Khamraeva, est l’un des rares espaces où cette identité peut être interrogée sans dogmatisme. « Nous ne faisons pas de théâtre pour glorifier ou imposer une mémoire nationale. Mais il est essentiel de montrer nos classiques, nos récits fondateurs. Les jeunes doivent savoir d’où ils viennent. »
Elle rappelle aussi que, malgré les politiques de modernisation, une grande partie de la population reste déconnectée du débat culturel global. « Beaucoup de nos jeunes n’ont pas accès aux livres, encore moins aux voyages. Le théâtre est alors une école de citoyenneté, une fenêtre sur le monde.
Résister au déclin du théâtre par l’innovation
Mais la metteuse en scène ne cache pas ses inquiétudes. Le théâtre, même en Asie centrale, souffre. Public vieillissant, dramaturgie contemporaine peu lisible, manque de financements… « C’est un phénomène mondial, constate-t-elle. Mais c’est d’autant plus grave chez nous, où le théâtre joue un rôle social central. » Pour résister, elle mise sur l’innovation — y compris technologique : festival numérique, partenariats avec des ministères du digital, échanges avec des ingénieurs du son sud-coréens…
Et elle croit en la force du collectif. « Nous avons cessé de croire que chaque pays doit exceller seul. La coopération régionale entre théâtres d’Asie centrale et du Caucase est indispensable. Ensemble, nous pouvons faire émerger un nouveau modèle culturel, propre à nos réalités. »
Avignon, carrefour des possibles
Sa venue à Avignon n’a rien d’anecdotique. Pour cette femme de théâtre, ce déplacement marque une nouvelle étape dans la reconnaissance de l’Asie centrale sur la carte culturelle mondiale. « Nous avons présenté une pièce en ouzbek, mais le public a compris. L’art, c’est un langage au-delà des mots. Ici, nous avons parlé avec le Brésil, avec la France, sans langue commune, mais avec un désir partagé de construire. »
Dans un contexte international tendu, la directrice ouzbèke plaide pour une diplomatie des scènes. « Quand la politique échoue, les artistes doivent prendre le relais. Le théâtre ne peut résoudre les conflits, mais il peut les prévenir — en réintroduisant l’empathie, le dialogue, l’humanité. C’est cette mission que nous portons, depuis Tachkent jusqu’à Avignon. »
Anastassia Chourova
 Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France
Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France