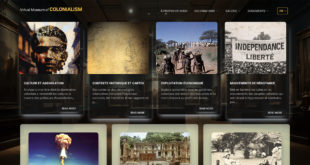Par Roland Laffite
Président de la SELEFA (Société d’Etudes Lexicographiques & Etymologiques Françaises & Arabes) : www.selefa.asso.fr
Secrétaire général de la Société des études saint-simoniennes
Roland Laffitte est auteur du livre : Voyage au pays de l’islamophobie, 2018. (À lire en ligne ici)
Ennemis mortels, le livre d’Olivier Le Cour Grandmaison paru à La Découverte en 2019 avec le sous-titre représentations de l’islam et politiques musulmanes en France à l’époque coloniale, vient d’être republié le mois d’août dernier à La Brèche avec un nouveau sous-titre : Les origines coloniales de l’islamophobie française. C’est très explicite et répond bien mieux à une question d’une actualité marquante. Nous vivons en effet un temps où des associations sont dissoutes et des particuliers condamnés pour le délit de lutte contre l’islamophobie, présentée sans honte comme une invention des mollahs iraniens pour disqualifier toute critique de l’islam. Et cela est fait par ceux-là mêmes qui apportent un soutien public éhonté au génocide en cours à Gaza, vu comme un combat contre un « islamisme » aux limites floues avec l’islam, dans un mouvement de revivification odieuse de l’esprit colonial.
Il y a effectivement un lien direct et étroit entre l’islamophobie contemporaine et la colonisation. Cela ressort clairement, sur le plan pratique, de l’application du Code de l’indigénat de 1881, comme cela est montré par l’auteur du livre dans le chapitre 5 du livre, intitulé « Islamophobie, gouvernement des “musulmans” et droit colonial » (notamment pp. 261 ss.). Le fameux Code établissait en effet, pour les « Français musulmans », reconnus par le sénatus-consulte de 1865 comme « sujets » sans droits à côté des « citoyens » titulaires de tous les droits civils et politiques modernes, des règles répressives discriminatoires, ce qui n’est pas sans incidence dans la psyché sociale contemporaine, quand identitaires et suprématistes refusent de voir leurs concitoyens musulmans comme de « vrais Français ».
Mais avant d’en arriver à la politique officielle marquée par l’islamophobie, l’auteur décrit, dans les premiers quatre chapitres, les multiples témoignages qui font des « Musulmans » fantasmés une « race ». Celle-ci serait irrémédiablement animée par une violence frénétique (Ch. 2), serait définitivement arriérée, fataliste si l’on songe au fameux mektoub et au sens de « résignation » fallacieusement donné au terme « islam » (Ch. 3). Cette « race » serait même affectée, c’est le comble, d’« hypersexualité » et d’une « sensualité » criminogène (Ch. 2), caractères curieusement semblables à ceux que les conquérants étatsuniens prêtaient en 1898 aux habitants de Cuba qui n’étaient pas musulmans, eux, mais catholiques. Cela pour dire que l’islam n’a rien à voir en l’occurrence et qu’il s’agit d’attributs généraux dont les colonisateurs affublent volontiers les colonisés pour les rabaisser et pour se parer eux-mêmes d’une justification morale.
Tous ces traits sont véhiculés par des « spécialistes » aussi nombreux que divers : orientalistes, historiens, géographes, juristes, ethnologues, psychiatres, hygiénistes, médecins légistes, mais aussi par des intellectuels et des écrivains célèbres de la IIIe République. Ils sont abondamment illustrés par des ouvrages de vulgarisation, par la presse et les manuels scolaires, et ont enfin inspiré les milieux de la politique. Ils découlent « naturellement », pour tout ce beau monde, de la religion islamique elle-même, comme cela fut expressément formulé par Ernest Renan, théoricien de la lutte contre l’islam mais aussi, ce que l’on sait moins, de la colonisation, dans des écrits de 1862 à 1883. L’islam est, selon lui, une religion fruste qui régit toutes les sphères de la vie sociale, s’oppose à la raison et la science, à toute pensée délicate et à tout progrès de la société. Après de verdict accablant, la sentence ne peut être que sans appel : réduit, dans une formule ramassée et efficace, à un bloc homogène qui traverse les siècles identique à lui-même, l’islam ne sera éliminé que par le triomphe de la civilisation européenne (voir notamment pp. 46-64). L’auteur de cette belle étude montre avec force illustrations comment le prestige scientifique du professeur au Collège de France, avec son aura républicaine d’opposant à l’Empire, a érigé cette « représentation savante » de l’islam en une vérité officielle qui a imprégné durablement tous les domaines de la connaissance.

Contre cette vulgate islamophobe qui a profondément instillé dans tous les secteurs de la société française, il existe deux sortes d’opposition extrêmes, entre lesquelles existent de multiples gradations. L’une est celle dont le maréchal Hubert Lyautey se fit un représentant mais sans être durablement suivi : elle s’inquiétait des menaces que faisait peser pour la domination impériale française la politique de négation et d’humiliation de l’islam (notamment pp. 126-29). C’est d’ailleurs dans ce courant que naquit, dès le début du XXe siècle, le terme islamophobie pour dénoncer, au sein même de l’administration coloniale, la politique néfaste menée contre l’islam. L’autre opposition fut celle, radicale mais marginale, illustrée par Charles Mismer, formé dans la tradition anticolonialiste du positivisme islamophile d’Auguste Comte et Pierre Laffitte (notamment pp. 59-61) : elle démonte pied à pied la thèse d’Ernest Renan sur l’islam, tant dans ses aspects historiques que contemporains.
On voit que la phobie contemporaine de l’islam, dans ses deux aspects, l’un intellectuel, l’autre socialement raciste, n’est pas neuve par rapport à celle qui sévissait à l’époque coloniale, et ses critiques non plus… Se replonger dans cette époque sert donc à mieux comprendre la nôtre.
Olivier Le Cour Grandmaison, Ennemis mortels : Les origines coloniales de l’islamophobie française, Paris : La Brèche 2025.
 Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France
Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France