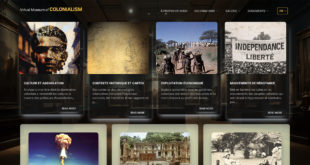Par Roland LAFFITTE
Après bien des tâtonnements et bien des « en même temps », Emmanuel Macron semble avoir enfin trouvé le rôle qu’il veut jouer dans l’histoire, celui de va-t’en guerre dans une croisade antirusse. C’était tout simple au temps de Joe Biden : il suffisait d’arborer le drapeau des vraies démocraties contre les autoritarismes. Ce front idéologique, qui nous vend les démocraties comme des sainte-nitouche libérales respectueuses des droits de l’homme et de la souveraineté des autres nations, fait des régimes autoritaires les sempiternels et uniques agresseurs, des agresseurs par nature. Mais le drapeau d’une croisade antiautoritaire s’est déchiré depuis qu’a succédé à Joe Biden, un Donald Trump à la démocratie curieuse.
Quittons donc les plateaux télé où se pavanent les généraux pour qui – n’hésitons pas à paraphraser un certain Clémenceau, pourtant champion des bellicistes – la géopolitique des militaires est à l’analyse géopolitique ce que la musique militaire est à la musique. En ces temps d’ardeur guerrière, considérons plutôt froidement les arrangements stratégiques et les alignements possibles des États qui, comme le disait, après le philosophe Nietzche, un politique nommé Charles de Gaulle, sont « des monstres froids ».
Le grand affrontement qui vient : États-Unis / Chine
L’antagonisme fondamental qui se dessine est aujourd’hui celui qui oppose les États-Unis d’Amérique et la Chine. Cette dernière dépasse désormais largement en masse productive – mesurée par la Banque mondiale en PIB / PPA (Produit intérieur brut en parité de pourvoir d’achat), qui est une manière plus pertinente de comparer la masse productive de différents pays que le PIB nominal donné en monnaie courante – les États-Unis : 35 milliards de dollars contre 27 en 2023. Le secrétaire général du Parti communiste chinois, Xi Jinping n’a-t-il pas déclaré pour enfoncer le clou, dans son discours d’ouverture du 20ᵉ congrès de son parti en octobre 2022, sa volonté de porter la Chine, à l’horizon du centenaire de la fondation de la République populaire, soit 2049, au « premier rang mondial » ? Il est manifeste que les États-Unis n’ont aucune intention de se laisser ravir leur place.
Après la chute du mur de Berlin, Zbigniew Brzezinski qui fut, sous la présidence de Jimmy Carter, l’artisan de la politique visant à faire de l’Afghanistan, « le Vietnam de l’Union soviétique », distingue en 1997 dans The Grand Chessboard, « le Grand Échiquier », trois objectifs dont la poursuite doit conserver États-Unis le statut de première puissance mondiale : continuer à diviser l’Europe, détacher de la Russie l’Ukraine, et contenir l’ascension de la Chine. Du côté républicain, s’impose alors au sein du think tank néoconservateur si bien nommé PNAC (Project for a New American Century), le programme qui sera exprimé en 2000 dans un document intitulé Rebuilding Americas’s Defenses: Strategy, Forces and Ressources for a New Century, et deviendra en matière internationale après le 11 septembre 2001, la bible de l’administration George Walker Bush. On y lit notamment : « Pour l’instant, les États-Unis n’ont aucun rival global. La grande stratégie de l’Amérique doit viser à préserver et à étendre cette position avantageuse aussi longtemps que possible dans le futur ». La Russie paraît alors avoir disparu de la scène internationale pour de longues années encore, et la grande masse des géopoliticiens s’occupe alors peu de la Chine, même si Samuel Huntington voit déjà cette aire civilisationnelle constituer à terme, avec celle d’Islam, un danger pour l’aire occidentale, groupant l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord dont le cœur (heartland) est constitué par États-Unis. Rester la première puissance mondiale en ayant une politique consistant à diviser l’Europe, à couper les ailes à la Russie et contenir la Chine fait donc consensus des stratèges étasuniens d’un bout à l’autre de l’éventail géopolitique.
Au début des années 2000, la montée en puissance de la Chine ne s’exprime toutefois encore que par un poids commercial grandissant, dont témoigne son admission à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en 2001. Mais les stratèges du PNAC considèrent déjà qu’il faut empêcher une éventuelle jonction entre Russie et Chine en Asie centrale. Ils sont en cela d’accord avec le Congrès qui vient d’adopter en 1999, une loi dite Silk Road Strategy Act, qui dessine les contours des intérêts de l’Empire américain dans la zone qui va de l’Arménie au Kirghizstan en passant par l’Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Ainsi, quand advient le 11 septembre 2001, il ne reste plus qu’à passer aux actes et à prendre directement pied dans cette zone à partir de l’Afghanistan. C’est le secret de l’occupation de ce pays, justifiée par la chasse à Al-Qaïda. Si l’on ajoute à cette visée le besoin d’une implantation solide au cœur de l’aire islamique dont la volatilité est vue comme la menace d’autres 11 septembre, et le besoin impérieux de contrôler les sources d’approvisionnement pétrolier de l’Europe, du Japon et de la Chine, on possède, sans chercher plus loin, un lot considérable de raisons suffisantes de la guerre d’anéantissement de l’Iraq en 2023.
Depuis cette époque, et bien plus tôt que prévu, la puissance russe s’est reconstituée. En témoignent successivement : la deuxième Guerre de Tchétchénie en 1999, le jeu hostile à la Révolution orange en 2004-2005 en Ukraine où sont largement ignorés les intérêts des populations russes et russophones, la Guerre russo-géorgienne en août 2008, enfin l’établissement d’un semi-protectorat militaire sur la Syrie en 2015. D’un autre côté, la Chine n’est pas seulement devenue dans cette période, la première puissance commerciale, un des principaux détenteurs de bons du Trésor étasunien, le premier investisseur et créancier de l’Afrique, et déjà le second en Amérique latine. Son projet de Nouvelles routes de la soie, engagé en 2017 où il est officiellement nommé yī dài yī lù, « une ceinture, une route », en anglais One Belt, One Road (OBOR), procède d’un enjeu géopolitique global, et est perçu par les États-Unis comme une menace réelle pour leur domination : il suffit de voir avec quelle brutalité Donald Trump vient d’écarter le consortium hongkongais qui tenait les ports des terminaux du canal de Panama, Balboa et Cristobal.
Dans cette perspective d’affrontement entre les grandes deux puissances globales, l’alignement de trois zones particulièrement importantes de la planète est recherché par les deux protagonistes : l’Inde, la Russie et l’Europe. Il conviendrait d’analyser les rapports réciproques de ces trois zones entre elles et avec les deux superpuissances. Laissons cependant de côté l’Inde qui recherche pour l’instant une position équidistante, et concentrons-nous sur la Russie et l’Europe, aujourd’hui entrées en Ukraine dans un conflit sanglant qui sera difficile à éteindre.
Le dilemme de la Russie
L’effondrement du régime soviétique et le démantèlement de l’URSS a provoqué une grave crise d’identité en Russie. Cet immense pays possède quatre façades : la première et la plus ancienne européenne, la seconde asiatique, qui résulte de la conquête de le Sibérie, et la troisième et la quatrième, que l’on oublie souvent, sont sur l’aire islamique où s’est joué, avec sa déroute en Afghanistan, le sort du régime soviétique, et les mers Baltique et Blanche dont les ports ont l’inconvénient d’être pris par les glaces une bonne partie de l’année. Historiquement, le tropisme de la Russie vers la façade méridionale est une constante : pas de véritable puissance sans que la flotte russe ait un accès dans les « mers chaudes », comme l’a montré récemment son installation à Tartous, remis en cause par le nouveau régime syrien. Quant à l’intérêt stratégique des deux autres façades, il est alternatif, au moins en temps de conflit. Jamais jusqu’à ce jour, la Russie n’a été capable de mobiliser sa puissance militaire classique des deux côtés en même temps. Il lui a fallu attendre l’effondrement de l’Allemagne en 1945 pour pouvoir mobiliser ses troupes vers le Japon, élan arrêté net par les deux bombes nucléaires étasuniennes et la capitulation de ce dernier.
Le caractère pacifique de la décennie 1990-2000, que l’on peut qualifier de période Boris Eltsine, permet à la Russie de mener un jeu égal entre la façade européenne et l’asiatique. Elle commence à l’Ouest avec l’entrée des capitaux qui servent à reconstruire l’économie et l’établissement de liens avec l’OTAN qui mènent à partir de 1994, à la signature de plusieurs accords de coopération importants dans le cadre du programme du Partenariat pour la paix. De l’autre côté, sont établis des liens avec la Chine et trois anciennes républiques soviétiques : Kazakhstan, Kirghizistan et Tadjikistan avec le traité de Shangaï de 1996 qui vise à stabiliser l’Asie centrale et à régler les vieux contentieux territoriaux. Sur cette lancée, naît en 2001 l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) qui renforce ce traité et l’étend à l’Ouzbékistan. Cela ne passe évidemment pas inaperçu à Washington qui cherche immédiatement, avec l’intervention en Afghanistan et l’installation de bases militaires dans la région, à mettre un coin entre la Chine et la Russie.
Dans la décennie suivante, Vladimir Poutine continue cette politique duale. Du fait de l’embargo européen et étasunien sur les armes dont souffre la Chine après la répression de Tien An men, ses achats permettent de remettre sur pied l’industrie militaire russe tandis que les échanges technologiques s’intensifient, surtout après la crise financière de 2008. Par ailleurs, après trois ans de travaux, est inauguré en 2009 l’oléoduc Восточная Сибирь ̵ Тихий океан [ВСТО], soit « Sibérie orientale ̵ océan Pacifique ». En même temps, sont formalisés les liens avec l’Europe et les États-Unis. La Russie entre dans le groupe des pays les plus industrialisés qui devient le G8 en 1997, et les liens avec l’OTAN s’intensifient, menant à la création, en mai 2002, du Conseil OTAN-Russie (COR), puis à des exercices militaires communs.
La politique étasunienne et otanesque n’en suscite pas moins des inquiétudes grandissantes en Russie. La question centrale est celle de l’extension de l’OTAN à l’Est. On aurait pu s’attendre à ce que la dissolution du pacte de Varsovie en 1989 s’accompagnât de la dissolution de l’OTAN qui avait été constitué en réponse à lui. Il n’en fut rien. Néanmoins, la réunification de l’Allemagne permise par Mikhaïl Gorbatchev en 1990 a été assorti de la promesse de geler la progression de l’OTAN à l’Est : « La juridiction militaire actuelle de l’OTAN ne s’étendra pas d’un pouce vers l’est », aurait affirmé James Baker à trois reprises. En dépit de ces paroles apaisantes, l’Alliance invitait, lors de la réunion au sommet à Madrid en 1997, la Hongrie, la Pologne et la Tchéquie à entamer des pourparlers d’adhésion, devenue effective en 1999, date à laquelle seront commencées des négociations pour l’entrée de la Bosnie, de la Croatie et de l’Albanie. Une nouvelle fournée d’invitations concerne la Bulgarie, les Pays baltes, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie en 2002, suivie de leur intégration à l’OTAN en mars 2004.
On peut comprendre que les pays qui ont souffert pendant un demi-siècle de la tutelle russe puissent nourrir quelques inquiétudes et demandent à être protégés. Au lieu de calmer ces inquiétudes par la recherche d’un accord avec la Russie, et malgré le programme du Partenariat pour la paix, l’Alliance atlantique pousse son avantage sur la Russie en poursuivant sa politique de containment des années de Guerre froide, qui trouve sa justification théorique dans l’éventail des stratèges étasuniens, tant dans le camp démocrate que républicain, ce qui ne les empêche pas de protester que cette expansion de l’OTAN serait « purement défensive ».
Ce mensonge manifeste vole pourtant en éclats quand les États-Unis répondent à la demande de la Pologne et de la Tchéquie faite en 2007 d’installer chez eux un bouclier antimissile. Il s’agit là de batteries de missiles anti-aérien longue portée Patriot PAC-3, et l’année suivante, on passe désormais aux missiles à mi-course SM-3. Le système est servi comme devant protéger l’Europe de l’Est contre de possibles missiles iraniens, mais pourquoi l’installer si près des frontières russes ? En plein milieu du conflit russo-géorgien, le 12 août 2004, Zbigniew Brzezinski, dont les Russes savent tout le bien qu’il leur veut, écrit : « La Géorgie nous ouvre l’accès au pétrole et bientôt au gaz de l’Azerbaïdjan, de la mer Caspienne et de l’Asie centrale. Elle représente donc pour nous un atout stratégique majeur ». Expansion de l’OTAN « purement défensive », donc… L’invitation faite aux États-Unis et à l’Europe par Dmitry Medvedev, à l’occasion d’une visite à Berlin en juin 2008, à une « réflexion collective sur un nouveau traité de sécurité européenne » reste vaine. Pour toute réponse, les États-Unis signent le 20 août avec la Pologne l’accord pour l’installation de missiles sur son territoire. En dépit des accords passés avec l’OTAN toujours en vigueur, rien de tel pour qu’avec les bases étasuniennes en Afghanistan et en Asie centrale, la Russie se sente « encerclée ». C’est d’ailleurs le sentiment qu’exprime Dmitry Medvedev le 5 novembre, dans son discours sur l’état de la nation : il parle d’« expansion incessante de l’OTAN » et de « l’encerclement de la Russie avec des bases militaires ».
Peut-on imaginer les dirigeants russes n’aient pas lu The Grand Chessboard et l’idée exprimée par Zbigniew Brzezinski, à savoir que l’Ukraine est le « pivot géopolitique » de la politique est-européenne, que, « sans elle, la Russie cesse d’être un empire eurasien » ? C’est d’ailleurs l’expression de leur propre pensée : le nationalisme russe n’imagine pas une Ukraine séparée de la Russie et cette idée a largement conquis l’opinion publique de ce pays. Autant dire que le contrôle de l’Ukraine est le grand sujet de discorde avec l’Europe et les États-Unis. Qu’après plusieurs années d’affrontements entre partisans en Ukraine de l’alliance russe et partisans d’une alliance à l’Ouest, à l’instar de la Pologne, la Révolution orange de novembre 2008, qui suit la Révolution des roses géorgienne de 2003, tranche dans le vif : c’est la Communauté européenne et l’OTAN. Pour la Russie, rallier la Communauté européenne, passe encore du moins si les relations sont correctes avec cette dernière, mais intégrer l’OTAN, c’est mille fois NIET ! La neutralité de l’Ukraine n’est pas seulement un débat intérieur touchant à l’interprétation de la Constitution de 1991, c’est une question internationale majeure. Dans la mesure où la situation internationale se tend, la Russie, qui trouvait déjà que la location de Sébastopol prévue par l’accord de 2010 est très couteuse, craint que les différends avec l’Ukraine n’entraîne l’annulation de cet accord : la question de la possession de la Crimée, enjeu stratégique majeur pour la Russie militaire, amène cette dernière à franchir le pas de l’annexion.
Il n’est pas certain que l’épouvantable nettoyage ethnique des Tatars de Crimée opéré par Joseph Staline en mai 1944 ait suffi pour que la majorité des habitants du lieu approuvent la mainmise russe sur le pays. Il semble en revanche doper le nationalisme grand-russe et rehausser le prestige de Vladimir Poutine en Russie en dépit de son autoritarisme grandissant. Il est possible que le respect des droits des minorités russophones dans le Donbass comme en Ossétie du Sud et en Abkhazie aurait pu être réglé autrement en d’autres circonstances géopolitiques, mais dans la mesure où nous sommes arrivés sur le plan international à une point de rupture, c’est un prétexte et une occasion pour la Russie de pousser son soutien à ces minorités jusqu’au séparatisme et à l’annexion. La Russie n’attend plus que l’OTAN et l’Europe arrêtent de leur propre chef leur progression vers l’Est aux frontières occidentales de l’Ukraine. Après le test de l’opération en Géorgie qui s’avère positif pour sa politique, elle se décide en 2014 à utiliser la force dans cette question clé.
Dès lors, les rapports avec l’Ouest et l’Est s’inversent pour la Russie. Alors que l’OTAN coupe tout rapport avec elle, celle-ci accueille en 2018, les armées de la Chine et de la Mongolie dans le cadre d’un exercice militaire mobilisant des forces importantes. Les rapports industriels et technologiques se renforcent au point que, dès avant l’intervention en Ukraine de 2022, on a affaire à un véritable partenariat. Des deux côtés, depuis 2014, la guerre du Donbass est terrible : les Ukrainiens traitent leur minorité orientale comme des étrangers et les dissidents russes ne sont pas en reste. Du côté occidental, des tentatives sont faites pour stabiliser la question ukrainienne tandis que les discussions s’intensifient pour l’entrée dans la Communauté européenne. Mais, comme le révèlera Angela Merkel dans une entretien au Zeit en décembre 2022, le sentiment est que la guerre est devenue inévitable et que les entretiens de Minsk étaient faits pour « gagner du temps » (Zeit zu gewinnen), pour permette à l’Ukraine de s’armer. Ce n’étaient que simagrées. Autant dire que la surprise affichée lors de l’entrée des troupes russes en Ukraine le 24 février 2022, n’en est pas vraiment une.
Vladimir Poutine intervient en tout cas avec la brutalité dont il sait faire preuve depuis son entrée sur la scène politique. Si pour Boris Eltsine, les indépendantistes tchétchènes étaient en 1994-1996 présentés comme « des chiens enragés » qu’il fallait « abattre » comme tels, Vladimir Poutine promettait en 1999-2000, dans un langage des plus orduriers, d’aller « les buter jusque dans les chiottes ». Et la Seconde guerre de Tchétchénie assuma les caractères d’une véritable guerre d’extermination. Joe Biden ne trahit pas la vérité en traitant Vladimir Poutine de butcher et il applaudit au mandat de Cour pénale internationale (CPI) émis en mars 2026 contre lui, mais condamne celui de novembre 2024 contre Benyamin Netanyahu, qui mérite tout autant ce qualificatif. Il n’a pas grand mal, suivi en cela des gouvernements européens, à accuser la Russie de fouler aux pieds le droit international, mais il le fait très bien de son côté en fournissant à l’armée israélienne toutes les armes nécessaires dans sa répression à Gaza, même si cette dernière assume, dans sa disproportion même, sans parler de ses objectifs, des caractères génocidaires. Ce qui tend à prouver qu’il n’y aurait crime contre l’humanité que lorsqu’on s’en prend à un pays de ce côté-ci de l’« Occident civilisé », mais pas un peuple de l’autre de ce monde… Un deux poids-deux mesures inacceptable pour l’humanité, très mal ressenti dans le « Sud global » qui tend a se solidariser plutôt de la Russie que de l’Ukraine.
Pourtant, dans les faits, les États-Unis font preuve d’une certaine réticence en armant l’Ukraine. La montée en puissance de leur aide militaire se fait sans conviction, toujours bien après la formulation des demandes ukrainiennes, pour ne pas dire à reculons, tandis que plusieurs responsables étasuniens, parmi lesquels le secrétaire d’État à la Défense, Lloyd Austin, ne cachent pas qu’en tout état de cause, la Crimée restera russe. C’est que, depuis la présidence de Barak Obama, tous les radars de la politique étasunienne sont braqués sur la Chine. Certes, Joe Biden reste un homme de la vieille école que l’on pourrait qualifier d’européenne dont les yeux restent largement fixés sur la Russie, mais il ne peut rien faire contre la véritable dérive des continents civilisationnels en cours, qui a déjà déplacé l’épicentre des affaires mondiales de l’Atlantique vers le Pacifique, ravalant l’Europe, elle qui avait autrefois dominé le monde jusqu’au début du XXe siècle, à une des périphéries du monde nouveau.
Au bout de trois ans de guerre en Ukraine, la nouvelle administration étasunienne change donc son fusil d’épaule. La guerre par procuration menée par l’OTAN contre la Russie avait pour double objectif, si l’on suit le fil tracé par les ténors de la pensée stratégique étasunienne, d’un côté affaiblir la Russie et, de l’autre, à s’assurer de la vassalité de l’Europe, ce qui mènerait à sa soumission dans un conflit avec la Chine. Mais la montée en puissance de cette dernière et son emprise sur la Russie ont déjà modifié la donne. Il ne s’agit plus seulement d’éviter que le conflit ukrainien ne provoque une guerre avec la Russie. Il s’agit désormais d’affaiblir la Chine en détachant ce pays d’elle. Qu’importent que les intérêts de l’Ukraine et de l’Europe en soient sacrifiés ! Tout cela n’est pas très neuf dans la politique étasunienne, mais en se libérant des vieux scrupules européens de Joe Biden, Donald Trump le fait avec une brutalité et une grossièreté inégalables.
L’Europe déboussolée
Le coup que reçoit l’Europe est extrêmement violent. Instrumentalisant les peurs compréhensibles d’un retour de la Russie sur ses anciennes possessions européennes, qui ont durement souffert de sa domination pendant près d’un demi-siècle, les idéologues étasuniens russophobes avaient lancé la politique d’extension de l’OTAN à l’Est. Les gouvernements d’Europe occidentale ont suivi volens nolens. Ils voient bien que la Russie en prend ombrage mais ils comptent sur le parapluie nucléaire étasunien pour se protéger de ses réactions. Ni l’ouverture économique de l’Allemagne ni celle, politique, de la France ne réussissent pourtant à effacer pour la Russie les effets désastreux de la marche vers l’Est de l’OTAN, surtout lorsque le sort de l’Ukraine, dont le détachement de la Russie est expressément formulé par les stratèges étasuniens, est mis à l’ordre du jour de la politique européenne.
La politique allemande vis-à-vis de la Russie prend l’allure d’une ample coopération économique. Elle est symbolisée par le projet, présenté en 2005 par Gerhard Schröder, de construire le gazoduc Nord Stream en mer Baltique afin d’éviter les conséquences des disputes russo-ukrainiennes de plus en plus graves sur l’approvisionnement en gaz russe de l’Allemagne, ce qui mènera son prometteur, poussé par Gazprom après sa démission de la chancellerie, à la présidence du conseil de surveillance du consortium germano-russe chargé de la construction et de l’exploitation dudit gazoduc. Angela Merkel, accusée après coup de prétendre aplanir les différends politiques par le commerce, poursuit la même politique, approuve en 2015 la construction de Nord Stream 2, qui sera d’ailleurs l’objet de critiques véhémentes de Donald Trump, motivées par l’idée de faire dépendre l’Allemagne et l’Europe du gaz de schiste étasunien plutôt que du gaz russe. Les deux gazoducs seront finalement sabotés en septembre 2023, apparemment par les services ukrainiens. Parallèlement, l’Allemagne de Merkel s’efforce de tenir la place, dans les années 2010, de principal fournisseur et de principal investisseur occidental en Russie.
Alors que l’Allemagne se lance dans un nouveau Drang nach Osten économique, la France cherche à reprendre avec Jacques Chirac le fil de la politique de rapprochement avec la Russie qui avait déjà pris nom d’Europe de l’Atlantique à l’Oural en 1963 avec Charles de Gaulle, puis de Confédération européenne de François Mitterrand, répondant à celui de Maison commune européenne, avancée par Mikhaïl Gorbatchev en 1988. Il n’est pas besoin d’aller chercher dans la passion de Chirac pour les civilisations orientales, la raison de ses efforts pour nouer des liens avec la Russie de Boris Eltsine. L’examen des forces en actions dans l’arène géopolitique suffit à comprendre que la vieille alliance de revers plus que séculaire vis-à-vis de l’Allemagne s’est transformée, depuis que des rapports durables sont établis avec elle, en besoin d’une pacification des relations du vieux continent européen avec la Russie, en suivant l’idée gaullienne d’une « troisième voie ». Sachant où a mené à Versailles la politique de Georges Clémenceau vis-à-vis de l’Allemagne, il est bien conscient qu’il ne faut pas « humilier la Russie » après la chute de l’URSS. Mais l’intervention de l’OTAN sans mandat de l’ONU au Kosovo en 1999, puis le fait qu’il ne s’oppose pas à l’extension de l’OTAN en 2004, peut-être pour ne pas aggraver le différend avec les États-Unis né à l’occasion du refus de la participation à la calamiteuse aventure iraquienne, vont à l’encontre du rapprochement recherché.
Quant à son successeur, Nicolas Sarkozy, il prétend poursuivre semblable politique. On sent toutefois, dès le sommet du G8 de Heiligendamm en juin 2007, où il sort complètement sonné d’un entretien avec Poutine, qu’il y a de l’eau dans le gaz. En novembre 2007 de la même année, il annonce devant le Congrès des États-Unis son projet que la France réintègre le commandement unifié de l’OTAN. En tant que président de l’Union européenne, il joue pendant l’été 2008, le médiateur dans le conflit russo-géorgien, arrachant à la Russie une stabilisation et la promesse ne pas annexer l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie. Le ministre des Affaires étrangères de l’époque, Bernard Kouchner, dit aujourd’hui que l’Europe a été « naïve » : il affirme que Vladimir Poutine a menti, qu’il n’a pas tenu sa parole. L’OTAN continue de l’étendre à l’Est et tend un oreille complaisante – rappelez-vous les paroles de Brzezinski – aux demandes d’adhésion de la Géorgie. La « naïveté » ne réside-t-elle pas dans la proclamation de Nicolas Sarkozy que « l’OTAN n’est pas pour la Russie un ennemi mais un partenaire » ? L’idée que la Russie puisse faire fi de la continuation de ce processus d’extension et dans l’acception de l’imposture que ce dernier est « purement défensif » ? De fait, la réintégration de la France dans le commandement unifié de L’OTAN est entérinée en avril 2009, comme si cette institution était neutre et que cet alignement pouvait être sans conséquence dans les rapports Europe / Russie.
Il se pourrait bien que le point de bascule de la Russie dans les rapports Ouest / Est ait été atteints au printemps 2011. Nous assistons en mai-juin à des exercices militaires communs OTAN-Russie, mais ce sont les derniers. La Russie qui a donné en février au Conseil de sécurité de l’ONU, son aval pour l’intervention voulue par la France en Libye, regrette en mars qu’en prenant cette opération en charge, l’OTAN « outrepasse son mandat » et lèse gravement les intérêts russes dans ce pays. La Russie se sent flouée. Désormais, les rapports avec ses voisins, qui étaient en équilibre au sommet de la pyramide, vont rouler de l’autre côté, et la parole de la France, qui est responsable en première personne de cette agression aux conséquences africaines et internationales catastrophiques, n’a plus aucun écho à Moscou.
En entendant les bruits de botte russes à la frontière ukrainienne, Emmanuel Macron tente bien, en se rendant à Moscou le 7 février 2022, de convaincre pendant cinq heures, dans le fameux tête-à-tête à six mètres de distance derrière une table de laque blanche aux feuilles d’or, son homologue d’arrêter la guerre imminente. Mais que met-il sur la table des négociations ? Sa proposition de « bâtir des garanties concrètes de sécurité » inclue-t-elle la promesse de s’opposer à l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN et à sa neutralisation, condition considérée par la Russie comme sine qua non pour lever la menace que cette dernière voit peser sur elle ? Et même s’il le promet, qu’est le poids de la France dans l’Europe et dans l’OTAN, qui commande dans l’Alliance atlantique ? Quinze jours plus tard, les jeux sont faits : les divisions russes franchissent la frontière et se dirigent vers la ville que nous avons longtemps nommée à la russe Kiev, mais qui est Kyiv pour les Ukrainiens.
Après trois années d’un conflit massacrant, après un million de morts et de blessés, on discute toujours des buts de guerre de Vladimir Poutine et des dirigeants russes.
Ceux qui font le plus de bruit sont les tenants de la thèse présentant Vladimir Poutine à la tête d’une Russie hypernationaliste tendue vers la conquête de l’Europe entière. Pour Nicolas Tenzer, philosophe politique apologiste de l’OTAN, qui n’aurait « jamais agressé personne » – les interventions en Serbie et en Libye et l’occupation de l’Afghanistan devaient peut-être étaient purement défensives ? – ou une historienne comme Françoise Tom, le but de guerre de Vladimir Poutine n’est pas seulement de conquérir et de détruire l’Ukraine, mais aussi « d’asservir les peuples européens ». Selon Pierre Sergent, essayiste militaire, il faut croire dur comme fer cette parole qu’aurait prononcée Vladimir Poutine devant des enfants en 2009 : « la frontière de la Russie ne se termine nulle part ». Cela les dérange moins lorsque l’État d’Israël, qui n’a jamais fixé ses frontières, met cette politique en pratique, mordant aujourd’hui sur le Liban et la Syrie. Si personne n’arrête Vladimir Poutine à Zaporijjia, c’en est fait demain d’Odessa et de Kyiv, après-demain des Pays baltes et de la Moldavie, et, dès qu’ils le pourront, les chars russes passeront le col de Saverne… Pourtant la petite armée ukrainienne a stoppé net l’élan de la grande armée russe vers Kyiv dans les premières semaines de la guerre en 2022, la contre-offensive sur Kherson en septembre de la même année préparée avec l’aide ses conseillers étasuniens, la percée réussie de Koursk en 2024, et, réciproquement, la progression aussi médiocre que laborieuse accomplie par les armées russes sur le front ukrainien dans les deux années qui ont suivi, cette perspective suffisent à prouver que cette l’affirmation d’un Bernard-Henri Lévy que l’assaut russe en Ukraine serait « le prélude à une guerre totale contre l’Europe », n’est pas très crédible. Si l’horizon ultime occidental de la Russie est conditionné par sa capacité de pousser ses armées, il n’est très éloigné des frontières des quatre oblasts annexés en 2022. Les gesticulations verbales russes sur l’utilisation du nucléaire n’y changent rien. Il est de bon ton de mettre la menace d’un seul côté, mais le propre de la dissuasion est que, même moins bruyante, la menace est terriblement réciproque : la publicité faite à l’exercice aérien nucléaire nommé Poker le 27 mars dernier en témoigne.
Bien des stratèges de plateaux télé rappellent que Vladimir Poutine a qualifié en 2005 la chute de l’URSS de « plus grande catastrophe géopolitique du siècle dernier », oubliant souvent qu’il ajoutait : « il serait vain la reconstituer ». Il est vrai qu’il n’a pas respecté l’accord de Moscou de janvier 1994, prévoyant que l’Ukraine cède ses armes nucléaires contre le soutien financier des États-Unis, confirmé et complété par le mémorandum de Budapest de décembre 1994, signé par la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Ukraine, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Russie, en annexant la Crimée et en intervenant au Donbass en 2014, puis en envoyant ses troupes en Ukraine en 2022. Aurait-il donc changé de projet ?
Sans imaginer que la Russie est prête à se porter, si on ne l’arrête pas, vers Varsovie, puis Berlin, et qui sait ? jusqu’à Brest, nombreux sont les géopoliticiens qui prêtent l’oreille aux nationalistes russes ultras prônant le rétablissement de la Grande Russie de Catherine II. Celle-ci intégra à la Russie d’aujourd’hui la Lituanie lors du partage de la Pologne de 1795 – Tallinn et Riga étaient déjà passées sous contrôle russe depuis 1710 et 1721 avec Pierre Ier lors de la Guerre du nord avec la Suède – et construisit la ville et le port d’Odessa en 1794. Dans cette hypothèse également, l’asservissement de Ukraine n’est qu’un début, si la Russie n’est pas arrêtée en Ukraine, ces pays sont en danger, mais, déployée par nombre de géopoliticiens, elle n’est pas radicalement différente de celle des jusqu’au-boutistes pour qui Paris est à terme menacé.
Selon les informations, distillées à point nommé, de services secrets de pays voisins qui se livrent à une surenchère alarmiste, la Russie, profitant d’un éventuel cessez-le-feu payé au prix cher par les Ukrainiens, aura encore renforcé sa puissance, par certains côtés mise à mal, mais par d’autres stimulée et par trois ans de « guerre de haute intensité », et serait prête à reprendre son extension sur la ligne allant de la Baltique à la mer Noire en envahissant les Pays baltes. L’Europe doit se préparer à s’y opposer, dans des termes parallèles à ceux qu’annoncent les Cassandre voyant déjà les Russes bivouaquer, comme au printemps 1814, dans les murs mêmes de Paris. Des personnalités connues comme Pierre Lellouche et Emmanuel Todd nient en mars 2024 la prétendue menace russe, et le second a cette phrase définitive : « L’inexistence d’une menace russe est un évidence ». Mais qu’importe !
Il est cocasse de voir nos dirigeants prendre des pauses guerrières et jusqu’auboutistes, à faire mine de continuer seuls la guerre contre la Russie, s’il le faut jusqu’au dernier ukrainien… Ils proclament que l’Europe doit s’armer immédiatement, « moralement et militairement », selon l’expression d’Emmanuel Macron dans son allocution du 5 mars, à la veille du Conseil européen réunissant les dirigeants des pays de l’Union européenne. Il s’agit de rattraper les retards que l’illusion du parapluie nucléaire étasunien a permis aux Européens d’accumuler. Keir Starmer, qui constate l’étiolement de la « relation spéciale » de son pays avec les États-Unis, et même le chancelier putatif Friedrich Merz, qui se voit condamné à rompre avec la pourtant très solide « tradition atlantiste » sont de la partie. Ces gens-là savent pourtant que se substituer entièrement aux États-Unis dans le soutien militaire à l’Ukraine est impossible avant longtemps sans l’accord du maître d’outre-Atlantique. Emmanuel Macron et Keir Starmer ont poussé Volodymyr Zelinsky à plier le genou à un moderne Canossa après que Donald Trump lui a tordu le bras devant les télévisions du monde entier. Voilà qui montre la limite des velléités européennes, cachées sous des discours martiaux prononcés à son de trompe : les États-Unis laissent tomber leurs « alliés » européens, mais ces derniers, en vassaux humiliés mais soumis, l’appellent encore à les protéger contre une Russie contre laquelle il les a poussés et, pis encore, avec laquelle il cherche à s’entendre contre eux…
Donald Trump s’est bien chargé de détromper les espoirs des Ukrainiens envers leur pays et l’OTAN, et il ne reste plus désormais à ces derniers de s’écrier : « C’est vous, Européens, que nous défendons contre la Russie ! ». Mais, après les premières proclamations dont les Européens eux-mêmes sont étonnés de l’audace, Français et Anglais en premiers sont très prudents quant à la « garantie de sécurité » que leurs pays sont prêts à donner à ce pays face à la Russie. Cette dernière se rétrécit comme peau de chagrin à chaque sommet européen de défense, et notamment celui de Paris du 27 mars : la fameuse « Force de réassurance » prévue autour du couple franco-britannique stationnée en Ukraine elle-même est bien maigre ne saurait, de toute façon, être mise en place qu’après un éventuel cessez-le feu, et encore sous la protection étasunienne. Mais comme les États-Unis ont tout à accorder aux Russes et que ces derniers posent comme condition à un cessez-le feu la démilitarisation de l’Ukraine et l’exclusion de toute troupe de pays de l’OTAN de son périmètre, autant dire jamais ! Il est fort probable que, devant l’impuissance de l’Europe, Volodymyr Zelinsky soit condamné à passer sous les fourches caudines de Donald Trump et à accepter sa protection de type mafieux dont on parle beaucoup : « Confie-moi tes centrales électriques, livre-moi ton sous-sol et peut-être demain davantage, et tu seras placé sous mon aile, car les Russes n’oseront pas me toucher, ce qui fait que tu seras en sécurité. Il est même possible que cette proposition cache un partage pur et simple du pays avec le nouvel ami russe avec qui il est l’égal en cynisme…
Pour ce qui est des Européens, les déclarations martiales se succèdent, des centaines de milliards d’euros sont promis à la défense européenne, 800 milliards d’euros chez Ursula von der Leyen par-ci pour l’Europe, plus de 1 000 milliards chez Friedrich Merz par-là pour l’Allemagne ! Et si pas un homme ne mourra pour l’Ukraine, il faut désormais préparer la jeunesse européenne, soumise à bombardement propagandiste d’un bellicisme rarement égalé, à mourir, dans trois ou cinq ans, pour l’Estonie où des 300 militaires français montent déjà la garde pour l’OTAN ! D’ailleurs, quoi de mieux qu’une économie de guerre pour échapper au marasme économique où la guerre par procuration contre la Russie l’a plongée depuis trois ans. Économie de guerre européenne contre économie de guerre russe, voilà un engrenage qui n’est pas sans danger. Emmanuel Todd affirme le 29 mars dans un entretien sur le site Élucid : le « continent qui a le plus à gagner de la paix, c’est l’Europe », même si c’est une tragédie pour l’Ukraine. Alors pourquoi les Européens veulent-ils la guerre ? C’est, selon lui, « pour exister »…
L’Europe face à la nouvelle donne géopolitique
Dans l’épisode dramatique que nous vivons, les dirigeants européens restent le nez rivé sur le conflit russo-ukrainien en figeant la réalité européenne dans l’exclusion de la Russie d’une Europe dont l’Ukraine serait la sentinelle avancée : ils calquent leur attitude sur celle du canard qui continue à marcher quand on lui coupé la tête. Ils ne se rendent pas compte que le déplacement de l’épicentre géopolitique dans l’océan Pacifique a déjà changé la donne mondiale. Afin de prendre le nouveau jeu géopolitique en compte, il est nécessaire de prendre du recul. Il faut s’éloigner de ce « petit cap du continent asiatique », selon l’expression de Paul Valéry il y a déjà un siècle, et porter son regard à l’échelle planétaire où les alignements se recomposent précisément autour d’un affrontement États-Unis / Chine.
Dans ces conditions, le conflit Ukraine / Russie devient mineur aux yeux des deux acteurs géopolitiques majeurs. L’affrontement entre eux s’exprime à ce jour dans la tentative de la Chine de mettre la Russie sous son emprise, devenue, à l’occasion de la guerre d’Ukraine, une véritable vassalité et, réciproquement, l’effort des États-Unis pour la soustraire à cette emprise. Pour grande que soit fascination de Donald Trump pour le charisme viriliste, conservateur et autoritaire de Vladimir Poutine qu’il contemple en miroir, elle n’explique pas les sacrifices auxquels sont prêts à consentir les États-Unis pour obtenir ce résultat. Même si certains, comme son ex-conseiller John Bolton accuse volontiers Donald Trump de n’avoir pas de « stratégie globale », c’est bien pour répondre à des intérêts étasuniens solidement établis à long terme que celui-ci n’hésite pas à passer l’allié ukrainien par pertes et profits. Lui-même n’a-t-il pas négligemment lâché en février, entre deux phrases, la possibilité que l’Ukraine devienne « russe un jour » ? Qu’importe même s’il faut piétiner les intérêts du « partenaire » européen, qui vivait l’illusion d’être un « allié ». La peur de la Russie dûment cultivée, et sa division dûment recherchée, le rende de toute façon impuissant et le poussent à une vassalité accrue. L’avenir dira jusqu’où l’administration étasunienne peut aller : supporter les contrattaques commerciales éventuelles, laisser tomber le commandement suprême de l’OTAN, ou même abandonner l’OTAN lui-même ? En tout cas, il semble bien que, pour elle, « toutes les options sont sur la table ».
« Qu’est-ce que la Russie ? », se demandait l’historienne Hélène Carrère d’Encausse à la fin des années 2010 : « Une nouvelle Russie, tournée vers l’Asie, en rupture avec son passé et sa vocation européenne ? Ou plus vraisemblablement peut-être une Russie qui ne veut plus camper à la périphérie de l’Europe, mais qui prétend assumer le double statut que la géographie et l’histoire ont confirmé, européenne et asiatique » ? Dans la mesure où les États-Unis parviendraient à détacher la Russie de la Chine, c’est en validant son statut de puissance, en abandonnant la politique de containment, qui n’avait rien de « défensive », mais était bel et bien agressive et conquérante, en ouvrant des négociations sur le contrôle partagé des voies maritimes arctiques, et en lançant une vaste coopération économique sur les matières premières et l’ouverture aux capitaux étasuniens. Quelle position, dans ces conditions, va être celle de l’Europe ? Mais rien n’est jamais acquis…
Cette position dépend en partie de la réponse donnée à question centrale qui est de savoir si la frontière orientale de l’Europe exclut la Russie ou l’inclut. Même s’il est difficile de l’exprimer dans le chaos mental des dirigeants européens qui, hébétés et sidérés, semblent perdre la tête, pris de panique par l’agitation de la menace russe qu’ils ont eux-mêmes contribué à exacerber, cette question est bien présente dans les esprits. En 1990, le futurologue Jacques Attali préconisait, dans son livre intitulé Lignes d’horizon, la formation d’un grand bloc Europe-Russie, parallèlement à la vision de Confédération européenne de François Mitterrand. On dira que les pronostications des futurologues valent celles des astrologues. Le même Jacques Attali n’hésite en tout cas pas à affirmer aujourd’hui, dans l’émission Le grand jury du 6 mars 2025, que « la Russie a sa place dans l’Union Européenne ». Mais il approuve en même temps la position définie par Emmanuel Macron, lequel se veut le chef de file d’un armement de l’Europe qui vise précisément la Russie comme un ennemi.
Bien des données contredisent l’idée d’une tranchée impossible à combler, définitive, entre l’Europe et la Russie. Considérons pour commencer les statistiques économiques que donne le FMI en 2017, pour que les chiffres ne soient pas perturbés par la guerre actuelle : le PIB par habitant en PPA, dont il a déjà été question précédemment, est de 29 000 dollars étasuniens pour la Russie, comme pour la Pologne (30 000 pour le Portugal), mais seulement 8 500 pour l’Ukraine, comme pour le Maroc ou les Philippines. Rappelons pour mémoire : 43 500 pour la France ou le Royaume-Uni. Même celui de la Roumanie et de la Bulgarie, qui ne sont pas considérés comme des pays particulièrement opulents, ont des chiffres qui s’élèvent respectivement à 24 000 et 22 000 dollars. On comprend que, du simple point économique, l’Ukraine attende davantage des rapports avec l’Union européenne, qui verse de confortables subventions à ses nouveaux venus, qu’avec la Russie, tandis que, par peur de sa puissante voisine, elle lorgne non seulement vers l’Union européenne, mais surtout vers les États-Unis et l’OTAN. Dans une « approche civilisationnelle » qui « met l’accent sur les liens culturels, personnels et historiques », Samuel Huntington considérait, dans son Clash of civilisations, que « la frontière civilisationnelle sépare l’Ukraine orthodoxe à l’est et l’Ukraine uniate à l’ouest », plus proche de la Pologne et de la Roumanie. S’il ne croyait pas à une guerre, il estimait cependant « possible que l’Ukraine se divise en deux ». Mais voir, du point de vue civilisationnel, un fossé infranchissable entre l’Europe occidentale et la Russie, reçoit un démenti cinglant de l’histoire. La Russie moderne est née en s’ouvrant à l’Europe. Sa culture et ses liens historiques la rapprochent bien plus d’elle que de la Chine. Il serait faux de considérer, comme le font aujourd’hui les jusqu’auboutistes russophobes, que la partie occidentale serait « civilisée » et que la partie orientale, comme la Russie, ne le serait point. L’Ukraine de Volodymyr Zelinsky n’est pas davantage face à la barbarie russe, que l’Israël de Benyamin Netanyahu face à l’Orient islamique, le rôle de « sentinelle avancée de l’Occident civilisé ». La question n’est pas tant civilisationnelle que géopolitique.
Au point d’exacerbation des différends euro-russes où nous sommes arrivés, est-il impossible d’inverser le courant qui entraîne la Russie vers l’est, d’imaginer, cinquante ans après Helsinki, un nouvel accord général de sécurité et de coopération en Europe, dans une Grande Europe incluant la Russie ? C’est probablement très difficile, étant donné les plaies réciproques provoquées par une bonne décennie de coups physiques et moraux portés de part et d’autre, mais la perspective mérite d’être explorée.
Que cherche la Russie ? à ce que cesse la poursuite progression de l’OTAN, selon la promesse faite par James Baker lors de la chute de l’URSS, progression qui a désormais atteint, avec l’Ukraine, le point limite absolu. Est-ce impensable ? Des gens qui ne sont pas des rêveurs éveillés évoquent aujourd’hui la « neutralité de l’Ukraine ». Nicolas Sarkozy osait le faire en août 2023 dans un entretien au site d’information européen Euroactiv : « l’Ukraine doit rester “neutre” et n’a pas sa place dans l’UE ». Même Volodymyr Zelinsky concédait le 29 mars 2022, lors de la médiation turque, que son gouvernement était « prêt à discuter de l’adoption d’un statut neutre dans le cadre d’un accord de paix avec la Russie ». Des forces politiques, comme c’est le cas à gauche du PCF de la LFI – laissons de côté l’extrême droite, qui se placent sur un terrain anti-européen – militent avec plus ou moins de conviction en France, pour le retrait du commandement unifié de l’OTAN. C’est sympathique, mais cela revient à s’arrêter à mi-chemin. Dans l’esprit d’un accord général avec la Russie, la question posée est celle de la continuation de l’OTAN, qui aurait dû être dissous en 1990.
Un partenariat énergique, comme celui passé hier avec l’Allemagne, n’exclurait pas des accords de fourniture avec la Chine, le Japon et l’inde, et la Russie y a tout à gagner. L’apport d’investissements européens pour la mobilisation des ressources énergétiques et minières vaudrait bien celle que Donald Trump laisse entrevoir pour les investissements étasuniens, idem pour une coopération technologique. Un accord général de sécurité européenne permettrait à la Russie de voir les Pays baltes comme un verrou stratégique sur la Baltique, et la prise en compte des intérêts des importantes minorités russophones de Lettonie et d’Estonie, réduirait la possibilité que ces questions soient pour la Russie un prétexte pour s’emparer de tout ou partie des Pays baltes.
Les tenants d’une croisade antirusse crieront à la naïveté, continueront à s’égosiller que l’on ne peut s’entendre avec la Russie, Poutine ou pas Poutine. Ce sont des gens à courte vue : l’Europe a, de son côté, énormément à gagner dans un tel accord général. La constitution d’un grand ensemble euro-asiatique permettrait à l’Europe de bénéficier de l’accès direct au Pacifique en temps de paix et lui donne, en temps de guerre, les bases d’une indépendance des deux camps, l’un mené par les États-Unis, l’autre par la Chine. L’Ukraine, aujourd’hui meurtrie et ravagée par une guerre insupportable verrait ses tensions identitaires apaisées et l’enjeu géostratégique qu’elle représente s’effacer, et il en est de même pour la Géorgie et l’Arménie. Pour l’Europe comme pour la Russie, c’est une telle perspective qui est propre à leur donner le maximum de moyens de rester à l’écart, si cela est possible, à un cataclysme planétaire. C’est là le point le plus important. L’histoire dira si c’est ou non possible.
Des deux côtés, la mobilisation belliciste ne prend pas le chemin d’une telle issue. Du côté russe, on ne réduit pas les attaques et cherche à prendre le maximum de gages en s’appuyant sur la complaisance de l’administration étasunienne. Du côté européen, la campagne de « réarmement » qui s’organise autour d’Emmanuel Macron va aussi en sens contraire puisqu’elle est dirigée contre la Russie présentée comme une nation ennemie contre qui la guerre est déjà commencée de façon hybride, et que l’on continue à couper les ponts avec elle, à établir un nouveau rideau de fer par une politique de sanctions accrues, dont de nombreuses sont sans retour. Cela pousse ce pays soit à une plus grande dépendance, aujourd’hui de la Chine, et demain peut-être vers les États-Unis, à cela aux dépens de l’Europe. Si les États-Unis renversent aujourd’hui leur attitude, ils n’ont pas renoncé à celle de diviser l’Europe et celle-ci va dès lors faire face à deux adversaire redoutables coalisés. Les pays européens risquent vraiment, même sans conflit militaire avec la Russie, d’être broyés et contraints à demander grâce aux maîtres étasuniens. Ils tomberaient ainsi tout cuits comme supplétifs des États-Unis dans le grand affrontement avec la Chine qu’ils ne pourraient éviter.
Vendredi 28 mars 2025.
_______________
Quelques travaux de l’auteur touchant à ce sujet :
* « Mais que cherchent les États-Unis ? », Témoignage chrétien du 1er déc. 1990.
* « Vers quel monde nouveau ? », dans Cahiers dans l’Orient n° 20, 4e trim. 1990.
* « À l’heure de la pax americana », Peuples méditerranéens n° 52-53, 1991.
* L’Irak sous le déluge, avec Naïma Lefkir-Laffitte, Paris : Hermé, 1992.
* États-Unis : La tentation de l’Empire global, été 2003, Paris : Les Cahiers de l’Orient Éditions, 2005, aujourd’hui en ligne sur rolandlaffitte.site.
* L’Irak, test pour l’Empire, coordination des Cahiers de l’Orient n° 72, 4e trim. 2003.
* « Mondialisation, libéralisme et monopole stratégique », publié en langue arabe dans la revue El-Badā’il, Beyrouth, n° 4, automne 2005 (version en langue française sur rolandlaffitte.site)
* « Le “Nouvel impérialisme libéral” : À propos de Robert Cooper », extrait du livre La Ronde des libérateurs de Bonaparte à Hollande, Paris : AlfAbarre, 2013.
* « Remarques sur le drame ukrainien », en ligne le 2 avril 2022 sur rolandlaffitte.site.
* Pour davantage de détails, voir la page L’Empire, hier et aujourd’hui, sur rolandlaffitte.site.
 Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France
Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France