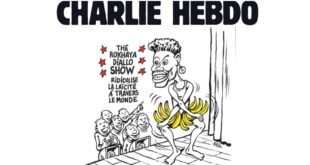Le négationnisme et le révisionnisme, qui consistent à nier ou chercher à atténuer les crimes contre l’humanité sont réprimés par la loi. Pourtant, l’un des pires crimes de l’histoire de France continue à être ignoré de la plupart de nos concitoyens : celui de la conquête de l’Algérie, puis de la guerre d’indépendance où les pires atrocités furent commises jusqu’à servir de modèles aux futures exterminations massives. Mais les nostalgiques de la France coloniale font de la résistance et, profitant de l’arrivée de la droite dure au pouvoir, poursuivent ceux qui auraient la volonté de lever le voile sur ces heures sombres de notre pays. Récemment, le journaliste Jean-Michel Aphatie a dû quitter RTL pour avoir les évoquées à l’antenne, et un reportage sur l’utilisation d’armes chimiques pendant la guerre d’Algérie a été déprogrammé.
LIRE AUSSI : « LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS S’ENLISE DANS L’OBESSION ANTI-ALGÉRIENNE »
Il est plus que jamais essentiel de poursuivre ce combat pour la vérité, et le livre d’Alain Ruscio « La première guerre d’Algérie, une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852 », y contribue fortement.
Le chercheur Roland Laffite, spécialiste du monde arabo-musulman et de l’islam, nous livre ici ses notes de lectures sur cet ouvrage à lire d’urgence.
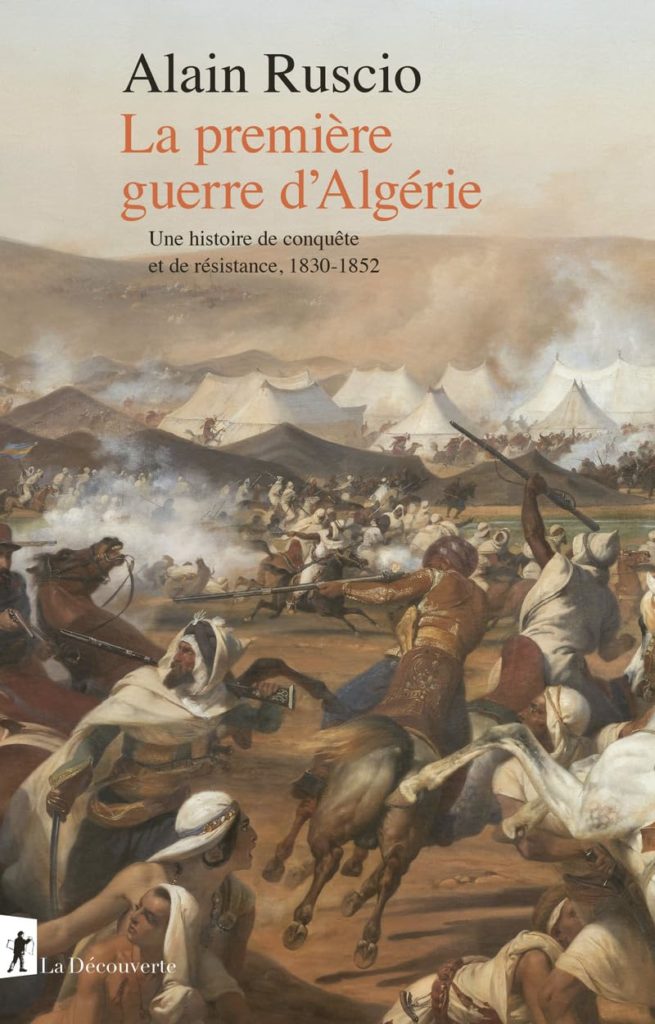
Dans l’opinion de la gent politico-médiatique qui submerge l’opinion publique, l’expression Guerre d’Algérie évoque ce que l’on nomme de ce côté-ci de la Méditerranée Guerre d’indépendance et de l’autre côté Révolution. Excellente idée que de rompre, comme le fait dans son dernier ouvrage Alain Ruscio, historien du fait colonial, avec ce récit commun qui charrie l’idée que tout se passait parfaitement bien entre Français et Algériens jusqu’au jour où, de façon quasi-inopinée, le FLN s’est lancé le 1er novembre 1954 dans une attaque qualifiée de « terroriste », nommée par les Français Toussaint rouge. Cet acte majeur fut accompagné d’une Déclaration d’Indépendance, auquel le ministre de l’Intérieur de l’époque, un certain François Mitterrand, réagissait ainsi : « L’Algérie, c’est la France, et la France ne reconnaîtra pas chez elle d’autre autorité que la sienne ».
La réalité est que le peuple algérien n’a jamais accepté cette autorité et qu’il a fallu, après l’expédition d’Alger de juin 1830 terminée par la prise d’Alger le 5 juillet suivant, 17 ans de lutte pour qu’Abd el-Kader rende les armes à l’Ouest, le 23 décembre 1847, et, on le sait moins, six mois après, le 5 juin 1848, pour que Ahmed Bey le fasse à l’Est. Mais la « pacification » du pays ne s’est pas terminée. La conquête du Djurdjura n’est acquise qu’en juillet 1857 avec la capture de Lalla Fatma N’Soumer, celle du Sud, entamée dès 1852 avec les prises sanglantes de Laghouat, de Touggourt et du Mzab en 1852, celle du Sud-ouest que lorsque s’épuisent les effets du soulèvement de Bouamama dans les années 1990, et cela sans parler de la grande insurrection de Moqrani en 1871. La conquête du Grand Sud, commencée en 1882, ne se terminait qu’au début du XXe siècle, époque où les élites algériennes passaient progressivement de la revendication de l’égalité des droits à celle de la reconnaissance de la personnalité algérienne, avant celle de l’indépendance, formulée dans les années 1920.
Alain Ruscio choisit, pour la Première Guerre d’Algérie, le terme du 16 octobre 1852, qui correspond au moment où Abd el-Kader est libéré par Napoléon III de sa prison d’Amboise, où, après Toulon et Pau, il avait été mis en détention par la IIe République, en dépit de la parole officielle de la France, donnée lors de sa reddition par le général Lamoricière et le duc d’Aumale.
Alain Ruscio fait le point sur les grandes questions concernant l’Algérie qui se posent à l’Histoire. Il nous fait revivre les prémices de la conquête dans la politique française, le déroulement de la prise d’Alger de 1830, avec le détestable sac de la Casbah. C’est ensuite la succession des débats qui mènent de la question du retrait ou de l’établissement de présides à celle de la conquête limitée ou totale, à l’installation ou non de colons, débats au cours desquels est rendu un hommage mérité au député Amédée Desjobert, farouche opposant à la conquête. Alain Ruscio qualifie à juste titre de « jeu de dupes » le traité de la Tafna en mai 1837 et sa rupture par les Français en octobre 1839. L’occupation en grand du pays étant ensuite décidée sous la conduite du célèbre Thomas Bugeaud qui arrive à Alger en janvier 1841, il en parcourt ensuite les grandes étapes. C’est alors la généralisation des « colonnes infernales », expression née pendant la répression de la Vendée en 1794 dont on sait l’horreur, et déjà pratiquées dans les années 1830. Elles sont menées par des officiers généraux dont on sait peu qu’ils ont l’expérience de l’expédition d’Orient en 1898-1902, où certains se vantent d’avoir appris comment « mener les Arabes », celle de la restauration de l’esclavage dans les Antilles et la lutte contre Toussaint Louverture, celle de la campagne d’Espagne dont nous connaissons les atrocités par les tableaux et les gravures de Francisco Goya, etc.
Cela dit, l’aspect peut-être le plus important de l’ouvrage d’Alain Ruscio est peut-être de montrer les effets de la conquête non seulement du côté du peuple conquis mais aussi du côté du conquérant.
Du côté algérien, on croit souvent connaître, mais sans mesurer vraiment l’ampleur des dévastations et des atrocités pourtant documentées par d’innombrables articles de journaux de l’époque et livres de l’époque, sans parler d’innombrables études historiques. Terre brûlée, massacres, exposition à des famines et épidémies massives dues aux ravages de la guerre, développement de maladies nouvelles, importées, dépopulation substantielle des zones occupées, complaisamment racontés par ceux qui des bouchers autosatisfaits comme Lucien de Montagnac ou le maréchal de Saint-Arnaud et justifiés, on le sait moins, par cette sainte-nitouche démocratique d’Alexis de Tocqueville. Décapitations, massacres et exactions de toutes sortes, enfumades et emmurements, comme ceux de 1844-1845, qui suscitèrent un émoi légitime dans la presse française. Mais encore expropriations massives, refoulement et cantonnement des populations dans les terres pauvres et arides ne permettant pas leur survie. Démantèlement de la société traditionnelle, de la vie urbaine et des activités autochtones, et constitution d’une armée de prolétaires devant vendre leurs bras chez les colons pour un prix dérisoire. Destruction des mosquées souvent transformées en écuries, profanation des cimetières, anéantissement de la vie sociale par l’accaparement des biens habous, c’est-à-dire des biens affectés en donations inaliénables aux institutions pieuses, ce qui ruine la vie religieuse et l’instruction jusque dans les zones les plus reculées du pays. Soumission des hiérarchies traditionnelles relativement souples et leur remplacement par une administration nouvelle, aux règles étrangères aux mœurs locales, à la justice pénale ressentie comme extrêmement plus dure que celle à laquelle les Algériens étaient habitués, une administration levant un impôt au seul profit des colons et soumettant les Algériens à la corvée pour la construction de routes servant avant tout l’occupant, etc. Constitution d’une masse humaine misérable ravalée à des conditions de vie dégradées, sans droits politiques, infériorisée, soumise au bon vouloir des occupants et à des lois pénales particulières qui mèneront le 28 juin 1881 au fameux Code de l’Indigénat, lequel sera ensuite appliqué à toutes les colonies. On mesure la rage de ces apologistes de la conquête et de la colonisation, qui, comme le propagandiste catholique ultramontain Louis Veuillot ou le médecin Eugène Bodichon, que les colons qualifiaient de « philanthrope », qui tous deux, au nom d’une prétendue « mission civilisatrice », réclamaient sans détour l’« extermination » des Arabes et des Musulmans. Au cours de son développement, Alain Ruscio écorne fort à propos le mythe de l’assainissement de la Mitidja, présentée par l’occupant comme un cloaque malsain, comme si les marais n’y n’étaient pas réduits à la région située au sud du Sahel d’Alger et comme si cette belle plaine n’était pas traditionnellement vantée par les poètes locaux comme la riche pourvoyeuse d’Alger en céréales et en fruits et légumes… La conquête française fut pour les Algériens un « combat inégal » contre un conquérant militairement surpuissant, et la parole est donnée à des historiens algériens contemporains, ce qui permet de mieux saisir le sens de la résistance du peuple agressé.
Réciproquement, on connaît moins les effets sur la société française. Alain Ruscio parle justement des « souffrances des hommes de troupe » : le malheureux contingent qui s’est livré, sous l’exemple de ses chefs, aux pillages et aux pires exactions, était en même temps équipé pour les pays tempérés d’Europe, mal nourri, en proie au mépris épais des officiers, et terrassé par une maladie généralisée, que les médecins appelaient alors la « nostalgie » et qui caractérisait l’état de déprime psychologique résultant de leurs conditions extrêmement pénibles. Le contingent français a perdu de 1830 à 1851, l’équivalent de ses effectifs en 1848, soit autour de 100 000 hommes. Un chiffre à peine inférieur à celui des colons, souvent misérables à qui l’on avait fait miroiter un paradis, ce qui fit une masse détestant aussi les autorités métropolitaines que les masses algériennes infériorisées, et qui comptaient seulement une minorité de Français, les émigrants préférant s’installer aux États-Unis ou au Brésil… En passant, Alain Ruscio démolit le mythe propagé par les Pieds-noirs qu’ils seraient des descendants des déportés de 1848 et de 1851 : sur les quelques centaines effectivement arrivées en Algérie, moins de 100 y resteront après l’amnistie de 1859. Cela dit, lorsqu’un simple homme du peuple devient un maître devant des dizaines et des centaines d’« indigènes », il prend vite des mauvaises habitudes. Et que dire des officiers ? Victor Hugo, qui avait dès le début appelé à propager la civilisation en Algérie, parlait en 1852 de « l’armée, faite féroce en Algérie », mais passait sous silence les massacres des 5 000 ouvriers parisiens de juin 1848, perpétrés par ces artisans de la Première Guerre d’Algérie, les Eugène Cavaignac et les Louis Juchault de Lamoricière, tandis que Nicolas Changarnier commandait la Garde nationale.
Roland Laffitte
Alain Ruscio, La première guerre d’Algérie, une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852, Paris : La Découverte, septembre 2024, 774 pages, 29,90 euros
 Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France
Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France