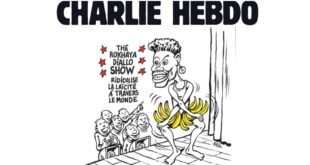Par Roland Laffitte
Chercheur, essayiste, spécialiste du monde arabo-musulman
La France est donc le 148e État à reconnaître l’État de Palestine. Il était plus que temps. Le nettoyage ethnique et le génocide commis à Gaza, désormais officiellement dénoncés comme tels par les organisations internationales, et le vote du 23 juillet à la Knesset pour l’annexion de la Cisjordanie, réclamaient au moins, avant que ce ne soit post mortem, la reconnaissance officielle de l’État de Palestine, l’affirmation symbolique que le peuple palestinien existe.
Au sortir de la Première Guerre mondiale, une Palestine emprisonnée
Cette reconnaissance est l’occasion de reprendre le fil de l’histoire du rapport de la France avec la Palestine. Laissons de côté l’histoire des projets français d’établissement des Juifs européens en Palestine qui sont nés au XIXe siècle et le refus obstiné à l’époque de l’Alliance israélite universelle. Rendons-nous directement au début du XXe siècle.
Le 16 mai 1916, les Accords Sykes-Picot prévoient le partage le Bilad al-Sham, la Syrie ottomane : au nord, une zone bleue pour la France, au sud, une zone rouge pour le Royaume-Uni : la Palestine, et une zone marron constituée des sandjaks de ᶜAkka (Acre) et d’al-Qods (Jérusalem) sous administration internationale, hormis les ports d’Acre et Haïfa sous contrôle britannique. La Palestine sous tutelle des grandes puissances donc.
Le 25 avril 1920, à la Conférence de San Remo, la zone française est fortement réduite en Anatolie, et amputée du gouvernorat de Mossoul au profit du Royaume-Uni, qui s’attribue également la Palestine déjà définie en 1916 dans ses limites internationales. Ceci en sachant que la Déclaration Balfour de 1917 prévoit, dans cette dernière, l’établissement d’un foyer national juif dont les bénéficiaires ne cachent leur volonté de le transformer en État juif au vu et au su de tout le monde, comme en témoigne le Rapport de la Commission King-Crane de 1919), qui condamnait cette perspective comme contraire au « du droit des peuples, même s’il revêt des formes légales [the forms of law] ».
Le 14 décembre 1922, la SDN valide le mandat britannique sur la Palestine.
En contrepartie de l’abandon de ce pays aux Britanniques, ces derniers laissent les Français libres de découper le nord de la Syrie à leur guise : en détacher notamment un Grand Liban autour de leurs protégés maronites contre l’avis quasi-unanime des populations locales, et découper le reste du pays en mini-États ethnico-confessionnels, maronite, druze, Alexandrette, Alep et Damas, selon les plans du Haut-commissaire au Levant Robert de Caix de Saint-Aymour, ce qu’empêche fort heureusement la Grande révolte druze de 1923.
Advient la Grande révolte arabe de 1936-1939, menée par Izz al-Din Qassam, figure emblématique de la Résistance palestinienne. Les insurgés présentés, selon la vieille coutume coloniale, comme des « terroristes, bandits, maraudeurs, voleurs et gangs », sont sauvagement réprimés par les Britanniques et les milices sionistes. À la suite de quoi le Royaume-Uni prévoit en 1937, selon les recommandations de la Commission Peel, une partition du pays entre les populations juives et arabes, mais ils optent finalement, en 1939, pour un Livre blanc qui abandonne l’idée de la partition en faveur d’un État unitaire gouverné de conserve par les Arabes et les Juifs dans les 10 ans, et ils limitent de façon draconienne l’immigration juive.
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au cours de laquelle les milices sionistes ont fait leurs armes en se joignant à l’armée britannique, l’administration mandataire s’oppose à l’afflux massif de réfugiés juifs provoqué par les conséquences de la Shoah et le refus, aujourd’hui volontiers passé sous silence, des pays vainqueurs à les recevoir chez eux. Alors que les représentants juifs et arabes adoptent des positions inconciliables et refusent les uns comme les autres toute idée d’État binational, le rapport britannique de Morrison et Grady revient en 1946 sur un plan de division de la Palestine en provinces autonomes dont les intérêts collectifs seraient gérés par une puissance mandataire, et le 4 octobre, le président Truman fait une déclaration favorable au partage. Puis, devant les difficultés rencontrées par l’administration britannique, le gouvernement Attlee cède le 18 avril 1847 son mandat aux Nations-Unies, crées en 1945. Celles-ci, qui sont sous la coupe des États-Unis, prennent les choses en mains en rupture complète avec les recommandations de l’administration Wilson et de la Commission King-Crane vingt-sept années plus, et mettent sur pied l’UNCOP (United Nations Special Committee on Palestine), qui prépare un plan de partage.
De son côté, l’Agence juive milite pour un État juif et une immigration libre pour les personnes déplacées juives de la Seconde Guerre mondiale, et elle se dit prête à accepter un partage du pays, comme proposé dans le Plan Peel de 1937, relevant la menace qu’une trop forte minorité arabe ferait peser sur le caractère juif de l’État.
Au sortir de la Deuxième Guerre Mondiale, Israël et Palestine : un « deux poids deux mesures » radical
Le 29 novembre 1947, un plan de partage de la Palestine est présenté aux Nations Unies : il prévoit de faire passer le territoire contrôlé par les Juifs de 1 650 à 14 000 km2 et ne laisse aux Palestiniens qu’un territoire de 11 500 km2, coupé de plus de façon artificielle, et en dépit des difficultés prévisibles d’administration, en deux parties : Cisjordanie et Gaza, ce qui mène à la Résolution 181, votée le même jour. Ayant probablement en tête la peur que la sympathie pour la Grande révolte arabe avait fait naître en Afrique du Nord, il semble que le gouvernement de Robert Schumann ait songé un moment à s’abstenir, mais une forte pression des États-Unis et la menace de couper les vivres l’incitent finalement à accepter cette proposition qui donne la part belle revendications sionistes, et, en même temps manifestement inégale et profondément injuste pour les Palestiniens.
Pour être validé, ce plan doit encore être voté par les deux parties. Mais jamais aucune consultation à cet effet n’aura lieu. Il est clair que la partie arabe le refuse ainsi que la Ligue arabe, mais l’autre partie s’empresse de l’accepter par la voix de la Ligue juive. En France, le soutien de ce plan par l’Alliance israélite universelle, antisioniste avant-guerre, est acquis de justesse. Mais aucune consultation populaire n’a lieu.

La Déclaration d’établissement de l’État d’Israël advient le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique sur la Palestine, manifestant ainsi que cet État prend symboliquement le relais du Royaume-Uni sur la Palestine et sans respect aucun pour la procédure prévue par l’ONU qui, considérant le refus arabe, avait préparé d’autres plans de partage. Peine perdue : sans attendre, les milices sionistes passent à l’attaque des villages palestiniens dans un but de terreur : le 12 décembre 1947, l’Irgoun faisait exploser une voiture piégée en face de la porte de Damas, provoquant la mort de 20 personnes. Ces actions se poursuivent sans discontinuer. Dans ce cours sanglant, un des massacres les plus connus de ceux qui ont provoqué l’exode des Palestiniens, est celui perpétré par l’Irgoun et le Lehi (Lohamei Herut Israël, « Combattants pour la liberté d’Israël »), une autre milice sioniste, à Deir Yassin : il provoque le 9 avril 1948 entre 77 et 120 morts villageois sans armes, et cela avant même la guerre par Israël en juillet 1948, déclenchée dans le but d’augmenter encore le territoire proposé par le plan de novembre 1947. Lors des accords d’armistice passés entre Israël et les pays arabes de février à juillet 1949, Israël aura expulsé 800 000 Palestiniens, catastrophe que ces derniers appellent la Nakba, tandis que son territoire, accru de 5 500 km2, comptera désormais 78% de la Palestine mandataire.
Alors que la guerre n’est pas finie, sans respect pour les revendications arabes et les droits des Palestiniens, et allant même contres ses propres propositions, l’Assemblée générale des Nations entérine de façon scandaleuse la brutalité du fait accompli sioniste : elle décide par la Résolution 273 (III) du 16 mai 1949, d’admettre cet État à l’Organisation des Nations Unies, sur la base de l’affirmation qu’Israël est « un État pacifique […] capable de remplir lesdites obligations et disposé à le faire ». Les maîtres de l’ONU atteignent assurément là un des sommets de cynisme et d’hypocrisie qu’on leur prête aujourd’hui bien à tort quand on oublie cet épisode révoltant. Et l’on voit qu’ils ont, dès le début, envers la Palestine, un lourd passif.
La suite prouvera ce qu’il en est du caractère résolument « pacifique » d’Israël, et de son aptitude ‒ de fait nulle ‒ à appliquer les résolutions des Nations unies, quand elles lui sont défavorables, notamment la Résolution 194 proclamant « le droit au retour des réfugiés palestiniens », votée pour se donner bonne conscience par l’Assemblée générale de Nations unies le 11 décembre 1948.
En tout cas, un deux poids deux mesures radical et tout à fait assumé : c’est « la dette infinie que l’Europe avait à l’égard des Juifs » que celle-ci « fait payer », comme l’affirmera Gilles Deleuze, « à un peuple innocent ». Et ceci avec une justification aussi détestable que fallacieuse : la défense d’un « enfant chéri » d’un Occident proclamé civilisé, « la chair de notre chair », à qui tout est permis, contre les Barbares, dont les demandes sont inaudibles, un véritable déni d’humanité du peuple palestinien…
Certes, le général de Gaulle décrètera bien l’embargo sur les armes à destination d’Israël en 1967, François Mitterrand et ses successeurs déclareront bien le droit des Palestiniens à un État, mais en contrepartie du « droit sacré d’Israël » à la sécurité. Et jamais la sécurité des Palestiniens, pourtant foulée aux pieds depuis plus de cent ans, ne sera évoquée. Toujours le deux poids deux mesures.
Épouvanté par le caractère de monstre de Frankenstein échappant à son créateur, qu’ont pris la « seule démocratie du Moyen-Orient » et « l’armée la plus morale du monde », et par les désastres du « droit inconditionnel à la défense » octroyé à Israël au détriment des autres peuples du Moyen-Orient, Emmanuel Macron s’est finalement résolu à mettre en pratique la promesse de la reconnaissance d’un État de Palestine lors de la session de l’Assemblée générale des Nations Unies de septembre 2025.
Il n’a même pas attendu pour prendre cette position que soit satisfaite la condition posée il y a peu de temps à la reconnaissance de l’État de Palestine, celle de de libération de quelques dizaines d’otages du Hamas, réclamée sans souffler mot des 10 000 otages d’Israël, enfermés en détention administrative renouvelable tous les six mois, ce qui permet de la rendre illimitée. Des otages israéliens dont l’échange est une des raisons publiques et avérée de la prise d’otages par le Hamas.
Un État libre ou un État-croupion ?
Mais de quel type d’État s’agit-il à ce jour ?
D’un État « débarrassé du Hamas » ? Comme si l’Algérie indépendante n’aurait pu être envisagée que « débarrassée du FLN ». Comme si, selon le droit international lui-même, Israël n’occupait pas la Palestine, et que le « droit à l’autodétermination » n’impliquait pas celui de « la lutte armée contre l’occupation étrangère et la colonisation ». Si tel n’était pas le cas, il faudrait rétrospectivement condamner la Résistance française contre l’Allemagne nazie ainsi que les luttes de libération contre les puissances coloniales, de l’Algérie au Vietnam, en passant quantité de pays.
D’un « État démilitarisé » ? Les Européens dénoncent le projet russe de démilitarisation de l’Ukraine comme irrecevable en avançant qu’il signifierait pour ce pays une perte de souveraineté ? Cela signifie que l’État de Palestine prévu n’aurait de souverain que le nom.
D’un État qui, comme le fait l’Autorité palestinienne sous la direction de Mahmoud Abbas, collabore avec les services de l’État israélien pour débusquer les adversaires de la « politique de sécurité » déterminée par le pays occupant ? Comme si l’on avait conditionné l’indépendance de l’Algérie en 1962 à la bonne volonté des Pieds-noirs et de l’OAS…
Toujours le deux poids deux mesures, d’un côté le Monde civilisé dont Israël reste la sentinelle, même si ses « excès » sont en train de « ternir son image », de l’autre, des Palestiniens barbares, qui doivent en tout état de cause, être maintenus « sous contrôle ». Et l’État que l’on promet aux Palestiniens n’est pas, en l’état, un État libre, mais un État sans souveraineté ni extérieure ni intérieure, en d’autres termes un État pour faire semblant, pire qu’un semblant d’État, un État-croupion…
L’État français tient une immense responsabilité dans la tragédie du peuple palestinien comme, de façon symétrique, dans le drame qui résulte d’avoir poussé les Juifs dans le piège historique de la colonisation de la Palestine. Tout cela est loin d’être fini. Nous avons encore devant nous de terribles épreuves.
 Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France
Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France