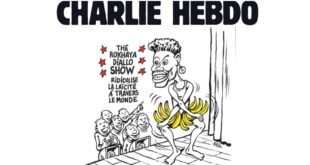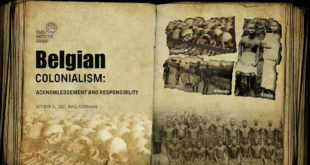Le 21 janvier 2025 se tenait en Azerbaïdjan une nouvelle session du Baku Initiative Group (Groupe d’Initiative de Bakou) consacrée à l’île de La Réunion. Appropriée par les Français en 1642, cette île de l’Océan Indien est devenue département français en 1946.
En réalité, si le statut administratif a mis un terme au fait colonial ; il n’en est pas de même pour le statut des populations autochtones, qui continuent à subir les diktats de la Métropole. Les structures sociales, politiques et économiques de l’île restent figées dans l’esprit colonial qui les ont façonnées. Aujourd’hui, ces femmes et ces hommes se mobilisent pour que l’île retrouve sa liberté. Le BIG leur a donné la parole lors de cette conférence exceptionnelle placée sur le thème : « La Réunion, un paradis sous occupation » Cette conférence avait pour objectif d’explorer les aspects historiques et contemporains du passé colonial de La Réunion, l’impact persistant de la domination française et les voies potentielles vers la souveraineté et l’autodétermination.
Les objectifs de la conférence
L’idée était d’engager une discussion critique entre chercheurs, militants, décideurs politiques et le grand public sur le processus de décolonisation et de l’indépendance de La Réunion, en examinant diverses thématiques liées à l’histoire coloniale, aux dynamiques politiques actuelles et aux trajectoires futures possibles. Des représentants d’autres territoires ultra-marins français étaient présents pour témoigner de leur propre expérience.
La note d’intention diffusée en annonce de la conférence par le Baku Initiative Group définissait ainsi les thèmes de la réunion :
- Le contexte Historique : Comprendre l’histoire coloniale de La Réunion, en mettant l’accent sur l’établissement de la domination française, l’importation de l’esclavage et le rôle de l’île dans l’empire global de la France. Les différentes communautés réunionnaises et leur arrivée à La Réunion.
- L’impact des politiques coloniales françaises : Étudier les effets durables des politiques coloniales françaises sur la vie sociale, économique et culturelle de la population réunionnaise, ainsi que sur les communautés marginalisées de l’île. La communauté Kaf (afrodescendants), la vie chère, le chômage, la précarité et le mal-logement.
- Les défis et tensions contemporains : Explorer les complexités du statut actuel de La Réunion en tant que département français (amendement Virapoullé, art 73 al 5 de la Constitution française), en abordant les questions d’autonomie politique, de dépendance économique et de lutte pour une gouvernance plus indépendante. Vision de la gouvernance d’un Etat réunionnais souverain.
- Des voies vers la décolonisation et la souveraineté : Examiner les perspectives de décolonisation/ de l’indépendance pour La Réunion. Projet économique, social, panafricaniste, réinscription de La Réunion sur la liste des territoires à décoloniser de l’ONU, l’internationalisme/ solidarité avec les peuples opprimés comme la Kanaky.
- Études comparatives : Faire des parallèles avec d’autres anciennes colonies et territoires français, notamment dans les Caraïbes et en Afrique, pour comprendre le mouvement de décolonisation au niveau mondial et son rapport avec La Réunion. La connexion avec les militants Kanak, l’exemple de la Kanaky dans la lutte, les similitudes avec les autres colonies françaises, le lien de notre lutte avec la perte de l’influence de la France en Afrique.
Le Groupe d’Initiative de Bakou, qu’est-ce que c’est ?
Abbas Abbasov, président du BIG, a précisé en introduction à la conférence quelles étaient les missions et les méthodes de cette ONG. Le Baku Initiative Groupe, fondé en 2023, se consacre à la promotion de partenariats internationaux dans les domaines de la décolonisation et des droits de l’homme. Le Groupe d’Initiative de Bakou soutient les luttes pour la liberté et l’indépendance de ceux qui vivent sous un joug colonial et néocolonial, en leur permettant de porter leur voix, auprès du public et auprès des organisations internationales. Simultanément, il s’intéresse à l’autonomisation des femmes, aux droits de l’homme, aux questions environnementales et culturelles. Il coordonne également les efforts des uns et des autres afin que cette solidarité participe à mettre un terme définitif à l’exploitation des peuples par des pays puissants cherchant à défendre, aux dépens de ces peuples, leurs intérêts économiques, financiers, stratégiques et politiques. Cette action s’inscrit dans la lignée du processus de décolonisation initié par l’ONU, mais de façon plus efficace, puisqu’elle n’est pas soumise aux éventuels vetos des puissances coloniales. La France, le Royaume-Uni, les USA et la Nouvelle-Zélande, sont considérés par l’ONU comme les dernières puissances coloniales.
La France sur la sellette
Naturellement, en tant que puissance coloniale majeure, la France est concernée au premier plan par les démarches du BIG, ce qui, tout aussi naturellement provoque l’ire des autorités françaises qui voient dans l’action du BIG d’une part une ingérence dans leurs affaires intérieures, et d’autre part une « réponse du berger à la bergère » au soutien de la France aux indépendantistes arméniens. En réalité, si la position partiale de la France dans l’affaire du Karabakh n’encourage pas l’Azerbaïdjan à lui trouver des excuses à sa politique coloniale – à quel titre le ferait-elle d’ailleurs ? – cette initiative n’a rien à voir avec la France en tant que telle. Elle est en fait étroitement liée à une caractéristique quasi fondatrice de l’Azerbaïdjan : le multi-culturalisme, et par conséquent le respect des cultures traditionnelles, qui sont, à l’inverse, les cibles principales des régimes coloniaux.
Une autre raison réside dans le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan que la France accuse d’avoir attaqué la « région arménienne du Karabakh », laquelle selon elle aurait eu droit à l’autodétermination. Alors que c’est exactement le contraire : c’est bien sûr l’Arménie, ou du moins des forces issues de la diaspora qui avait combattu au Liban qui ont envahi, en 1993, le Haut-Karabakh et les régions environnantes. Le déséquilibre militaire, à l’époque en faveur de l’Arménie a mis le monde devant le fait accompli, et les envahisseurs ont décrété que des terres leurs appartenaient, jusqu’à réécrire l’histoire de l’Azerbaïdjan en montant de toutes pièces un récit faisant du Karabakh la terre d’origine des Arméniens. On se trouve ici devant un classique de la démarche coloniale : on envahit une terre, on se l’approprie, et on procède au remplacement physique et culturel d’un peuple par un autre. Lutter contre un discours historique fabriqué fait partie du processus de décolonisation.
La Réunion au piège de l’esprit colonial français
Ses départements et territoires d’Outre-mer permettent à La France de doubler sa superficie. Or, même après les grandes décolonisations, comme celles du Maghreb, l’esprit colonial perdure au sein des « possessions françaises ».
Mais qu’est-ce que l’esprit colonial français ? Contrairement à l’empire britannique, qui favorisait une gouvernance indirecte et s’appuyait sur des structures locales, la colonisation française a été marquée par une politique d’assimilation. Ce modèle repose sur l’idée que les populations colonisées doivent adopter la langue, les valeurs et les institutions françaises pour devenir des « citoyens » à part entière. Pourtant, cette égalité apparente n’était qu’une façade : derrière les discours paternalistes des métropolitains se cachait une oppression culturelle et raciale.Pire. La contradiction entre l’appropriation de terres lointaines, l’expropriation de leurs habitants, et les valeurs humanistes des lumières ont conduit à vouloir cacher ces crimes sous le prétexte d’une prétendue « mission civilisatrice ». Nous entendons encore des nostalgiques de la colonisation affirmer qu’ « on leur a apporté la culture ». Non : on a nié les cultures locales. Pendant la colonisation, la religion locale est devenue une superstition, la culture locale est devenue du folklore, la langue locale a été considérée comme un patois. C’est sur cette négation de l’autre que la colonisation a essayé d’imposer sa culture et ses traditions.
L’agression culturelle est aussi grave que l’agression physique, même si les deux sont liées : L’un des exemples les plus tragiques fut, en Afrique, le chemin de fer « Congo-Océan », qui permettait de faire transiter jusqu’à la mer les richesses du sol volées au Congo par les colons français. Sa construction a provoqué la mort de près d’un million de congolais tués à la tâche. Ce qui fait dire aujourd’hui aux descendants des victimes : « La France n’a pas construit un chemin de fer pour les Congolais, ce sont les Congolais qui ont construit, dans le sang, un chemin de fer pour les Français ». De même, la négation de l’identité algérienne a conduit aux massacres perpétrés par les troupes française, depuis le Maréchal Bugeaud jusqu’à la guerre de libération.
À La Réunion, l’assimilation a pris une forme particulière. Peuplée à l’origine d’une population insulaire à laquelle est venue s’ajouter des esclaves, des engagés venus d’Inde, de Chine et de Madagascar, et bien sûr de colons, l’île a vu sa diversité culturelle étouffée par un système colonial valorisant uniquement la culture européenne. Les langues locales, comme le créole réunionnais, ont été marginalisées dans l’espace public et éducatif, tandis que la culture et l’histoire locales étaient minimisées, voire effacées, des discours officiels. Cette politique d’assimilation a eu pour effet de dévaloriser les identités réunionnaises au profit d’un pseudo-idéal métropolitain.
Mais en donnant à l’Île de la Réunion le statut de département, la France pensait avoir tué dans l’œuf toute velléité d’indépendance ou d’autonomie des peuples autochtones de l’île, et il y a réussi jusqu’ici. Sauf qu’aujourd’hui, les temps ont changé. Ce qui paraissait normal et acceptable hier, ne l’est plus aujourd’hui. Les peuples s’émancipent contre le fait colonial, les pays devenus indépendants se libèrent du néo-colonialisme. L’exclusion de la France de son pré-carré africain en est un exemple. Les accusations d’ingérence ou d’appétits étrangers ne font que masquer l’incapacité des dirigeants français à comprendre qu’il fart désormais changer de paradigme et nouer, avec les nations indépendantes, des liens d’égal à égal. À la Réunion, La jeunesse n’est plus la jeunesse soumise, en quête d’assimilation, qu’avait souhaité la métropole. Elle est à la recherche de ses racines et a commencé à se lever contre l’oppression silencieuse. C’est dans ce contexte que s’est formé le parti Ka-Ubuntu.
Ka-Ubuntu, l’éveil de la jeunesse réunionnaise
« Ka-Ubuntu est une organisation indépendantiste et panafricaniste fondée il y a 5 ans par 3 jeunes réunionnais. » a expliqué Romain Catambara, président du mouvement, « Le Ka désigne l’énergie vitale ou l’énergie divine qu’on retrouve au sein de tous les êtres vivants sur cette terre. Ubuntu est une philosophie bantoue qui promeut la solidarité, l’humanité. Le terme ubuntu est lié au proverbe bantou « Umuntu ngumuntu ngabantu » qui signifie « Je suis ce que je suis, parce que vous êtes ce que vous êtes ». Ici nous avons pris ce terme en opposition à l’individualisme mis en avant par le capitalisme occidental. ».
Ka-Ubuntu s’est donné pour objectif de libérer La Réunion des modèles économique, culturel et politique imposés par la colonisation. Pour Romain Catambara, le modèle économique mis en place par les colons a entraîné une dépendance économique et sociale et une marginalisation économique durable de l’île. L’économie locale repose largement sur les importations, favorisant les entreprises métropolitaines et maintenant l’île dans une position de dépendance. Par ailleurs, les inégalités foncières, héritées de la période esclavagiste, perdurent : une grande partie des terres agricoles reste aux mains de descendants de colons. La dépendance aux produits importés, la taxe de l’octroi de mer et le monopole économique du Groupe Bernard Hayot, contribuent à la vie chère sur le plan économique à La Réunion. Par ailleurs, dès la départementalisation de 1946, il a été procédé à une désindustrialisation de La Réunion , de façon à ce qu’elle n’ait jamais les moyens d’être autonome. La Réunion est devenue une économie de service.
Ce système économique a des conséquences désastreuses sur le plan social avec le taux de chômage important chez les jeunes, la dépendance d’une bonne partie de la population aux aides sociales. « La Réunion fait partie des départements français les plus touchés par le chômage avec la Guadeloupe, la Guyane et Mayotte. 71,5% des 15 à 24 ans sont sans activité. Le chômage chez les jeunes des 15-24 ans touche 47.4%. A La Réunion, presque 100.000 personnes bénéficient du RSA (revenu de solidarité active) qui est une assistance pour les personnes les plus précaires. Et 60% des bénéficiaires sont des femmes. Nous avons également entre 115 000 et 200 000 personnes en situation d’illettrisme soit environ 25% du peuple réunionnais. A La Réunion, il y a 41 000 jeunes de 15 à 29 ans qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. », note Romain Catambara.
36% des Réunionnais soit 319.300 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Le taux de pauvreté est plus élevé chez les moins de 30 ans soit 51.6%. Environ 200.000 réunionnais sont touchés par la crise du logement. 30.000 personnes n’ont pas de logement personnel, 75.000 personnes vivent dans des logements où ils n’ont pas accès à l’eau chaude et parfois ni douche, ni WC intérieurs, et 18.000 dans des logements insalubres. Il y a actuellement 45.000 demandes de logements à La Réunion, soit une augmentation de 60% en six ans, et l’année dernière seuls 1600 logements ont été livrés. Ces inégalités économiques s’accompagnent d’un sentiment de relégation : les Réunionnais, bien que citoyens français, sont souvent perçus comme des Français de seconde zone.
Crimes sans châtiments
L’illustration de ce suprémacisme blanc méprisant, de cette tenaille constituée d’un discours paternaliste d’un côté, et d’une oppression physique de l’autre a été particulièrement meurtrière dans les années 60, l’une des périodes les plus sombres dans l’histoire de La Réunion, Dès 1965 Michel Debré, alors député de l’île, a mis en place des politiques de contrôle des naissances aux conséquences catastrophiques. Ainsi que l’a rappelé Benjamin Clement, l’un des dirigeants de Ka Ubuntu, une méthode particulièrement choquante, et même criminelle, a été l’utilisation massive de la stérilisation forcée ou de la contraception imposée sans consentement éclairé. Des milliers de femmes réunionnaises noires et malbaraises (d’origine indienne). ont été victimes de ces pratiques, souvent sous prétexte médical. Elles allaient consulter à la clinique pour un mal bénin, puis ressortait avec les trompes ligaturées, les ovaires parfois enlevés. Les médecins mentaient aux femmes en leur disant : « On vous a opéré de l’apendicite ». Mais ils tuaient les enfants à l’intérieur de ces femmes. En leur injectant du Depo Provera, un produit que l’on administrait aux vaches en France.
Cette campagne s’inscrivait dans une vision paternaliste, où les élites métropolitaines estimaient que la population réunionnaise n’était pas capable de gérer sa propre natalité. Malgré les procès intentés par certains victimes comme les « 30 courageuses », les responsables de ces crimes, les médecins notamment, n’ont jamais été inquiétés : En février 1971, trente femmes noires (les « 30 courageuses », ) portent plainte devant un tribunal composés de juges et d’avocats blancs très puissants contre le docteur David Moreau, Conseiller Général, responsable de la clinique de Saint-Benoît, qui a organisé les avortements forcés. Il était marié avec la fille du PDG des sucreries de Bourbon (dont la fortune s’est construite sur l’esclavage), président du syndicat des médecins, faisait partie des plus gros propriétaires de terrains et d’immeubles dans le chef-lieu Saint-Denis, possédant plusieurs commerces, et était un grand ami de Michel Debré. Quand, fraîchement élu, ce dernier a débarqué à La Réunion, sa première déclaration a été : « Le problème numéro 1, c’est la démographie, le grand mal de ce pays…Les réunionnaises ont une sexualité « tropicale débridée » et « infantile », qu’il faut discipliner », ajoutant : « la fainéantise alimentée par la naissance d’enfants nombreux ».
Marc Jacquet, le ministre des transports de l’époque avait renchéri : « L’avortement est la seule solution valable au problème démographique tragique dans ce département. (…) Ces femmes sont frustrées. Elles confondent hémorragie et règles normales. Pas la peine de discuter avec elles.«
Tout cela 5 ans avant la loi Veil autorisant l’avortement en France. « Les femmes dont les vies ont été détruites, n’ont reçu aucun dédommagement, mais on a dédommagé les maris que l’on considérait comme propriétaire du fœtus » s’est indigné Benjamiçjn Clément. « Un peu comme le dédommagement des propriétaires d’esclaves à l’abolition de l’esclavage, qui ont perçu 2% du PIB National pour préserver l’équilibre économique, soit l’équivalent de 27 milliards d’euro aujourd’hui. C’est ça l’état colonial, un état qui se construit sur le mensonge, le viol, et finance les actes terroristes. Les criminels médecins, infirmiers et politiciens ont reçu plusieurs centaines de millions de francs grâce au dispositif de l’AMG : l’assistance médical gratuite : l’état était complice de ces crimes. »
Les panneaux publicitaires présentaient une affiche qui montrait une boîte de sardine avec plein de petites têtes d’enfants noires à l’intérieur avec comme titre : « Trop c’est trop. Assez ! » avec l’adresse de la clinique Saint-Benoît à côté. Le Dr Moreau n’a jamais été condamné, ce qui valu à La Réunion le surnom de « L’île du Dr Moreau », en référence à un célèbre romain d’horreur d’H.G. Wells.
A la même époque, la déportation des « Enfants dans la Creuse » reste l’un des épisodes les plus effrayants de cet esprit colonial. Entre 1963 et 1982, des milliers d’enfants réunionnais ont été arrachés à leurs familles pour être envoyés en métropole, soi-disant dans le but de leur offrir un avenir meilleur. Ces enfants, déracinés et souvent placés dans des conditions précaires, ont été utilisés pour repeupler des régions rurales françaises touchées par l’exode. Derrière cette politique se cachait une logique coloniale brutale : les familles réunionnaises étaient jugées incapables de s’occuper de leurs enfants, et la culture locale était considérée comme un obstacle à leur « intégration ».
La projection de deux films racontant ces épisodes tragiques de la colonisation réunionnaises a été suivi d’un silence glacial. « La société réunionnaise s’est bâtie sur les crimes coloniaux, les viols et les mensonges. Une histoire qui n’a pas été raconté, une histoire qui n’a pas été digérée. Mais lorsque nous la regardons en face, en reconnaissant toutes ses facettes tant sombres que lumineuses, nous pouvons reprendre confiance en nous, nous pouvons ressentir cette puissance cachée à l’intérieur de nous, laissé par nos ancêtres marons, qui se sont toujours battues pour une société juste et équitable. Nous nous plaçons dans la continuité de ce combat. Nous avons l’intelligence, la force, et la créativité pour mener à bien ce combat. Nous savons que nous allons gagner. Ce n’est qu’une question de temps. » a martelé Benjamin Clément.
Le discours colonial face à la jeunesse d’aujourd’hui
Le discours colonialiste ou néo colonialiste des représentants de la métropole ou des familles d’anciens colons est tellement présent qu’il a fini par trouver un certain écho dans l’ensemble des territoires ultra-marins français où, aujourd’hui encore, les autorités tentent de faire taire les voix qui s’élèvent contre ce discours. Aujourd’hui encore, la France déporte et emprisonne les indépendantistes kanak sans jugement. Une partie du peuple est assimilé et pense encore aujourd’hui que si nous avons des problèmes c’est à cause des pauvres qui font trop d’enfants, et que sans la France, nous sommes voués à l’échec. Mais les Réunionnais sont désormais engagés dans un processus de réappropriation culturelle et identitaire. Ce mouvement prend diverses formes, allant de la valorisation du créole dans la littérature et la musique à la reconnaissance de l’histoire de l’esclavage et de l’engagisme. La langue créole, longtemps dévalorisée et exclue de l’espace public, est aujourd’hui revendiquée comme un symbole de l’identité réunionnaise. Des initiatives locales visent à l’introduire dans les écoles et à en faire un vecteur de transmission culturelle. De même, les traditions culturelles, telles que la musique maloya – inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO – jouent un rôle central dans cette redéfinition identitaire. Un autre enjeu majeur pour La Réunion est la reconstruction d’une mémoire collective. Pendant des décennies, l’histoire de l’esclavage et de la colonisation a été occultée dans les récits officiels, contribuant à un sentiment de dévalorisation chez les populations d’origine africaine, indienne et malgache. Aujourd’hui, des initiatives locales et nationales visent à réhabiliter cette mémoire, notamment à travers des commémorations, des musées et des projets éducatifs.
Indépendance ?
Que faire face à cette volonté continue d’assimilation, c’est à dire de négation des cultures spécifiques ? Comment faire confiance à la métropole pour faire vivre les traditions spécifiques au peuple réunionnais, alors qu’elle cherche par tous les moyens de les étouffer ? Romain Catambara prend pour exemple l’article 73 alinéa 5 de la Constitution française, appelé « amendement Virapoullé » dont l’objectif est de maintenir l’île dans une totale dépendance politique de la métropole. Par cet article, toutes les dispositions législatives prises par le parlement français, qui se situe à 10.000 km de nos côtes, s’appliquent de plein droit à La Réunion. « Nos responsables politiques locaux ne sont pas en mesure d’adapter ces lois par rapport à nos spécificités ou de prendre des mesures spécifiques à nos réalités » indique Romain Catamabara. Voilà pourquoi « nous voulons l’indépendance pour décider par nous-mêmes, pour nous-mêmes de nos propres lois, notre propre système politique. »
Mais qu’on ne s’y trompe pas : « Pour Ka-Ubuntu, l’indépendance n’est pas le but ultime, mais c’est une étape pour permettre le développement du pays. » précise Romain Catamabara . Simplement, « le meilleur remède face à cette maladie qui est le colonialisme français qui porte atteinte à l’intégrité physique et mentale du peuple réunionnais, le médicament, est la souveraineté, l’indépendance . Ainsi, pour nous l’indépendance est le point de départ pour construire une Réunion où régnera la justice sociale, la justice économique, avec un système social qui améliorera les conditions de vie matérielles des Réunionnais ». La tâche n’est pas aisée, y compris auprès de la population réunionnaise, soumise à un véritable matraquage idéologique, faisant de l’indépendance une question taboue, diabolisé ou tournée en dérision. Pour les militants indépendantistes, l’indépendance, contrairement à ce qu’affirment leurs détracteurs, ne signifie pas la misère, la pauvreté, comme voudraient le faire croire les autorités françaises qui prétendent que la Réunion indépendante finirait comme les Comores, sans préciser que la situation des Comores est la conséquence de la déstabilisation de la France. « Pour nous l’indépendance c’est la liberté de construire un avenir meilleur pour notre peuple » confirme Romain Catamabara.
Les indépendantistes de La Réunion veulent s’inscrire dans la lignée des « marrons », ces esclaves des plantations qui, dès le XVIIe siècle, avaient échappé à leurs bourreaux et avaient construit leur propre société. Ils se placent également dans les pas des indépendantistes réunionnais du 20e siècle comme Jean-Baptiste Ponama, et Serge Sinamalé qui avaient fondé le Mouvement pour l’Indépendance de La Réunion (MIR) en 1981. Un mouvement soutenu à l’époque par Kadhafi.
L’indépendance : une affaire internationale
Après la départementalisation en 1946, La Réunion a été retirée des territoires à décoloniser car selon la métropole, la départementalisation signifiait la fin de la colonisation, alors qu’en réalité, c’était la continuité de la colonisation sous une autre forme. Pour Romain Catambara, l’objectif de Ka-Ubuntu est de faire en sorte que La Réunion soit réinscrite sur la liste des territoires à décoloniser de l’ONU. Un autre objectif est d’obtenir le soutien d’autres États qui s’opposent au colonialisme, car prôner l’indépendance face à la 6e puissance mondiale, membre permanent du conseil de sécurité de l’ONU, qui a droit de véto à l’ONU est une véritable épreuve de Sisyphe. Surtout que les juridictions internationales n’ont pas le pouvoir d’imposer leurs décisions aux Etats qui ne respecteraient pas leurs engagements internationaux. Un exemple criant est celui de l’île de Mayotte, à propos de laquelle la France a été condamnée plusieurs fois par les Nations Unies pour occupation illégale, L’ONU demandait également de restituer l’île de Mayotte aux Comores. Le droit de veto de la France a rendu la décision caduque, preuve supplémentaire la France, qui se dit pays des droits de l’homme, ne respecte pas ses engagements internationaux.
Mais on assiste aujourd’hui à un basculement géopolitique avec des pays qui décident de contester l’hégémonie occidentale et rebattre les cartes du système international. « On voit ici que dans un avenir proche cela pourrait être une opportunité pour nos peuples, nos pays colonisés qu’à travers le droit international nous puissions accéder à l’indépendance » se réjouit Romain Catambara.
Le panafricanisme
L’autre ligne directrice de Ka-Ubuntu est le panafricanisme, c’est-à-dire l’union des peuples africains dans les domaines économiques, culturels, militaires et de faire en sorte que l’Afrique puisse parler d’une seule voix sur la scène internationale. « Pour nous, le panafricanisme est l’outil qui peut permettre aux peuples africains d’accéder à l’indépendance. Dans peuple africains, nous incluons le peuple réunionnais qui vit sur une île africaine, dont l’histoire, la culture sont fortement rattachées au continent africain et qui est majoritairement composé d’afrodescendants. » explique Romain Catambara. Le panafricanisme est nécessaire. « En effet, le Burkina Faso seul ne pourra pas parler d’égal à égal avec des puissances comme la Chine, les USA ou autres, pareil pour le Mali ou l’Ethiopie et tous les autres pays africains. C’est également le cas pour La Réunion, si notre pays devient indépendant sans s’unir au continent africain, qui est notre allié naturel, dans ce cas on se séparera d’un pays impérialiste pour tomber entre les mains d’un autre pays impérialiste. Cependant, si tous les pays africains s’unissent et parlent d’une seule voix, alors nous pourrons parler d’égal à égal avec les autres puissances et imposer le respect. »
En réalité, la France utilise Mayotte et La Réunion pour assurer son hégémonie dans la région. Les FAZSOI (Force armées de la zone sud de l’océan Indien) qui sont basées à La Réunion et Mayotte afin de contrôler la région. C’est également grâce aux FAZSOI que la France occupe illégalement les îles éparses de Madagascar. D’ailleurs, la justice internationale a demandé à la France de restituer les îles éparses à Madagascar et Mayotte aux Comores. Mais elle refuse car en occupant Mayotte et les îles éparses, elle prend le contrôle des champs pétrolifères du canal du Mozambique. Par ailleurs, grâce à la présence de ses militaires dans la région, elle peut contrôler la route commerciale du Canal du Mozambique pour son approvisionnement et celui de l’Europe. Ainsi, a souligné Romain Catambara, « la France qui se dit pays des Lumières, pays des droits de l’Homme, pays démocratique se comporte comme un délinquant en ne respectant pas le droit international. Raison pour laquelle Ka-Ubuntu dans son combat pour l’indépendance soutient ses frères et sœurs de Madagascar, des Comores dans leur lutte pour leur souveraineté territoriale. »
Exiger des réparations
Ces revendications ne doivent pas en faire oublier d’autres, a rappelé Benjamin Clément : celles qui consistent à obtenir réparations des préjudices subis pendant l’occupation française, notamment le dédommagement des violences inhumaines infligés aux esclaves, aux crimes commis contre les « marrons », le remboursement des primes versés aux « chasseurs de noirs » (hommes de main envoyés par les propriétaires pour tuer les esclaves évadés) fugitifs , le recensement précis des indemnisations versées à l’ensemble des propriétaires d’esclaves lors de l’abolition, et leur reversement raux descendants d’esclaves, et associations pour la réparation de la communauté Kaf (personnes d’origine malgache ou africaine descendant d’esclaves ou d’« engagés »).
Ka-Ubuntu demandé également le remboursement des profits colossaux générés par les grands groupes industriels nés du système esclavagiste/colonial : Groupe Bernard Hayot, Dechâteauvieux, Isautier, TEREOS, Chatel, etc… et la redistribution des terres accordées aux propriétaires d’esclaves durant l’esclavage et à l’abolition, aux kaf qui ont fait en sorte que ces terres soient fertiles. Le processus de réparation passera par un travail mémoriel, par exemple en racontant l’histoire du maronnage, en créant dans l’espace public des lieux de mémoire célébrant le marronage, ses rois et ses reine. Il s’agira aussi, comme cela s’est fait dans d’autres pays libérés, de remplacer certains noms de rues et boulevards portant les noms de grands colons criminels, par des rois et reines marrons.
Et maintenant ?
La Réunion illustre de manière poignante la persistance les contradictions de l’esprit colonial français, mêlant idéaux universalistes et pratiques discriminatoires. Mais aujourd’hui, les Réunionnais sont engagés dans un processus de réappropriation identitaire et de reconstruction mémorielle, tout en cherchant à définir un avenir émancipé de l’héritage colonial. Cette conférence a constitué une véritable plateforme pour un dialogue critique et une collaboration interdisciplinaire, contribuant à une compréhension plus profonde du cheminement de La Réunion vers sa souveraineté. En réfléchissant au passé colonial de l’île et en discutant de son avenir, elle a contribué à stimuler un engagement renouvelé en faveur de la décolonisation, de l’indépendance et de la reconnaissance de l’identité politique et culturelle. Une question demeure : la France est-elle prête à reconnaître pleinement les spécificités de ses territoires d’outre-mer et à rompre avec un modèle encore imprégné de colonialisme ?
Jean-Michel Brun
 Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France
Musulmans en France L'actualité des musulmanes et musulmans en France